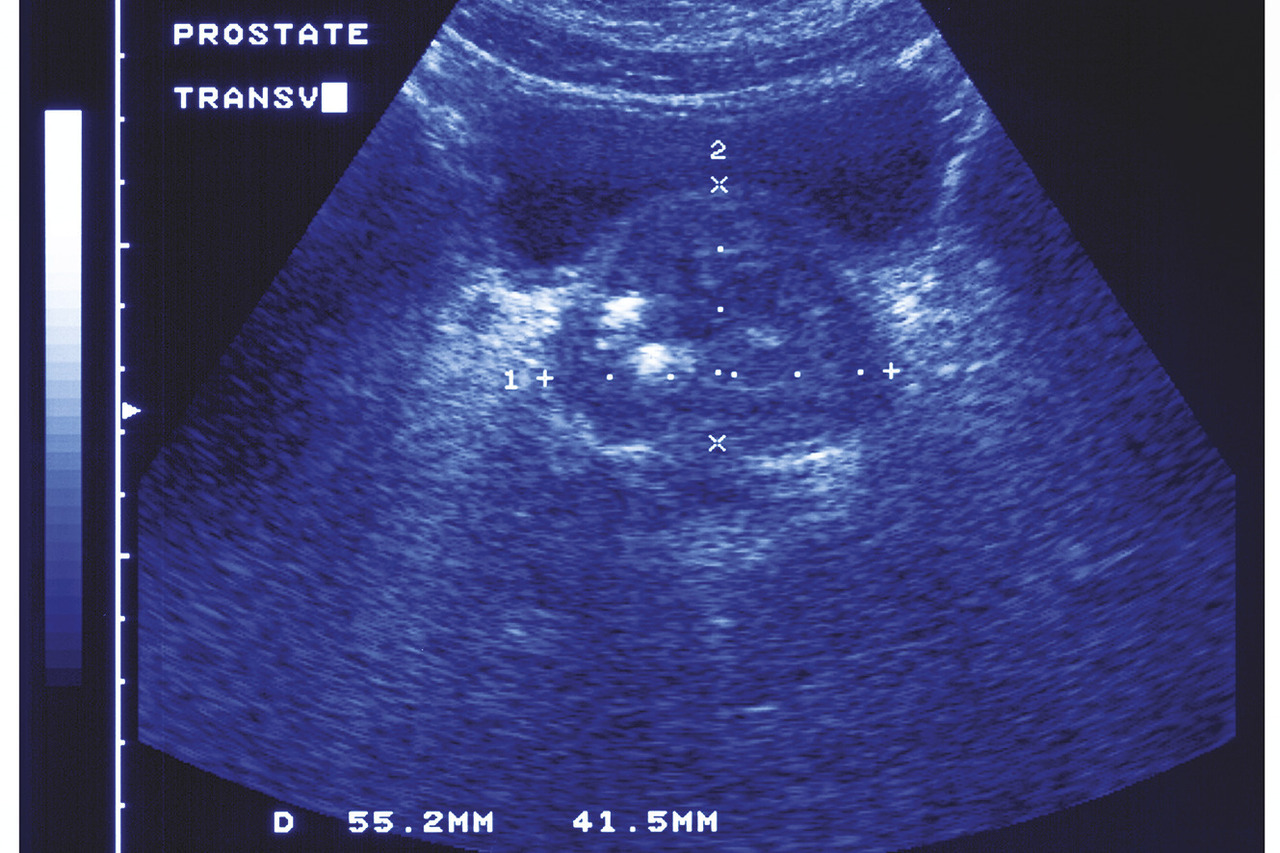« Quelle cacophonie ! Je mets au défi les médecins traitants et a fortiori les hommes concernés d’avoir des idées claires sur la question parce que ce débat, sur le dépistage du cancer de la prostate, oppose les praticiens et les théoriciens. »*
Ce qui paraît une évidence pour d’autres cancers (sein, côlon…) – à savoir le dépistage systématique – ne l’est pas pour le cancer de la prostate, pourtant cancer le plus fréquent de l’homme et deuxième source de mortalité. On peut s’en étonner. Des points de vue divergents ont été émis par des autorités indiscutables. Des recommandations ont été édictées, censées être suivies par l’ensemble des praticiens auxquels s’impose le respect des règles de l’art et des données acquises de la science, dont elles sont partie intégrante. Ces recommandations ont pu paraître contradictoires. Dès lors, lesquelles suivre ? Cette ambiguïté n’est-elle pas pour le médecin source de mise en cause ? L’abord du problème sous cet angle peut paraître « corporatiste », mais il concerne une vraie problématique dans la pratique médicale quotidienne.
Plus que des divergences, une véritable polémique !
Ce sujet, qui devrait, comme dans bien d’autres domaines de la médecine préventive, être plutôt consensuel, fait l’objet de divergences marquées d’opinions, qui parfois ont atteint le niveau d’une véritable polémique entre théoriciens et praticiens. Mais le débat ne s’est pas limité à ces deux catégories, supposées bien séparées.
Entre médecins, dans différents médias ou publications, des propos ont pu être virulents. Les uns, généralistes, parlant du « lobbying intense de la part des urologues français par l’intermédiaire de l’Association française d’urologie (AFU) », laissant entendre même à la limite une attitude mercantile !
Dans un éditorial au titre accrocheur, « Dépistage du cancer de la prostate, un autre scandale sanitaire ? », publié dans la revue Médecine en mars 2012, des professeurs de santé publique écrivent : « Le marketing de l’AFU est agressif et il s’est poursuivi, insensible aux données qui s’accumulaient… »
De tels propos, même très argumentés, sont excessifs et ne font qu’aggraver les interrogations légitimes des patients et de leur médecin.
Pourtant, le 2 mars 2013, Patrick Coloby, président de l’AFU, concluait sagement sur le site Urofrance : « l’AFU et les médecins généralistes doivent travailler ensemble dans cette voie… », à savoir « la promotion de la science urologique au service du patient… », et dans les dernières recommandations de l’AFU, on notait que « la stratégie de détection précoce doit être évaluée conjointement par l’AFU et les agences de santé ».
On a vu cependant se dessiner ces dernières années un apaisement et un certain rapprochement « rassurant » des points de vue.
Entre médecins, dans différents médias ou publications, des propos ont pu être virulents. Les uns, généralistes, parlant du « lobbying intense de la part des urologues français par l’intermédiaire de l’Association française d’urologie (AFU) », laissant entendre même à la limite une attitude mercantile !
Dans un éditorial au titre accrocheur, « Dépistage du cancer de la prostate, un autre scandale sanitaire ? », publié dans la revue Médecine en mars 2012, des professeurs de santé publique écrivent : « Le marketing de l’AFU est agressif et il s’est poursuivi, insensible aux données qui s’accumulaient… »
De tels propos, même très argumentés, sont excessifs et ne font qu’aggraver les interrogations légitimes des patients et de leur médecin.
Pourtant, le 2 mars 2013, Patrick Coloby, président de l’AFU, concluait sagement sur le site Urofrance : « l’AFU et les médecins généralistes doivent travailler ensemble dans cette voie… », à savoir « la promotion de la science urologique au service du patient… », et dans les dernières recommandations de l’AFU, on notait que « la stratégie de détection précoce doit être évaluée conjointement par l’AFU et les agences de santé ».
On a vu cependant se dessiner ces dernières années un apaisement et un certain rapprochement « rassurant » des points de vue.
Quels sont les enjeux ?
Deux intérêts sont concomitamment en jeu :
– celui du patient, avec la détection à temps d’une maladie potentiellement curable, au prix d’une thérapeutique la mieux adaptée et la moins invalidante ;
– celui du praticien, afin d’éviter un risque de mise en cause pour manque de diligence dans l’établissement d’un diagnostic à l’origine pour le patient d’une perte de chance, ce qui, rappelons-le, pour le praticien, revient à retenir à son encontre un comportement fautif.
Que faire, dès lors, en pratique ? Sur quelles recommandations « caler » cette pratique quotidienne ?
L’incertitude provient du fait que les recommandations découlent de l’analyse d’études dont les résultats – et donc les conclusions ! – sont systématiquement et réciproquement contestés sur le plan méthodologique, à plus ou moins long terme.
Ci-dessous sont rappelés les préconisations divergentes, la nature juridique des organismes qui les émettent et leur éventuelle hiérarchisation, la valeur juridique des recommandations et la réalité de leur opposabilité, l’état limité actuel de la jurisprudence judiciaire ; une attitude de bon sens applicable en pratique quotidienne est ensuite proposée.
– celui du patient, avec la détection à temps d’une maladie potentiellement curable, au prix d’une thérapeutique la mieux adaptée et la moins invalidante ;
– celui du praticien, afin d’éviter un risque de mise en cause pour manque de diligence dans l’établissement d’un diagnostic à l’origine pour le patient d’une perte de chance, ce qui, rappelons-le, pour le praticien, revient à retenir à son encontre un comportement fautif.
Que faire, dès lors, en pratique ? Sur quelles recommandations « caler » cette pratique quotidienne ?
L’incertitude provient du fait que les recommandations découlent de l’analyse d’études dont les résultats – et donc les conclusions ! – sont systématiquement et réciproquement contestés sur le plan méthodologique, à plus ou moins long terme.
Ci-dessous sont rappelés les préconisations divergentes, la nature juridique des organismes qui les émettent et leur éventuelle hiérarchisation, la valeur juridique des recommandations et la réalité de leur opposabilité, l’état limité actuel de la jurisprudence judiciaire ; une attitude de bon sens applicable en pratique quotidienne est ensuite proposée.
Des recommandations divergentes, voire contradictoires ?
Émanant de la Haute Autorité de santé
Dès janvier 1999, l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes), précurseur de la Haute Autorité de santé (HAS), concluait : « Les connaissances actuelles ne permettent pas de recommander un dépistage de masse du cancer de la prostate… »
Conformément à ses précédents avis dans un rapport d’orientation de février 2012, la HAS rappelle que « Les connaissances actuelles ne permettent pas de recommander un dépistage systématique, en population générale, du cancer de la prostate par dosage de l’antigène spécifique de la prostate (PSA) ».
De plus, concernant les populations à haut risque, elle concluait :
– « qu’en l’état actuel des connaissances, des difficultés sont identifiées pour définir et repérer des populations masculines à plus haut risque de développer un cancer de la prostate ;
– que l’identification des groupes d’hommes plus à risque de développer un cancer de la prostate ne suffit pas à elle seule à justifier un dépistage ;
– qu’il n’a pas pu être retrouvé d’éléments scientifiques permettant de justifier un dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA des populations masculines considérées comme plus à risque ».
Dans un dernier document datant de mai 2013, la HAS, dans une actualisation du référentiel de pratiques de l’examen périodique de santé concernant le dépistage précoce du cancer de la prostate, réaffirme que « la balance bénéfice-risque est en défaveur du dépistage du cancer de la prostate ».
Conformément à ses précédents avis dans un rapport d’orientation de février 2012, la HAS rappelle que « Les connaissances actuelles ne permettent pas de recommander un dépistage systématique, en population générale, du cancer de la prostate par dosage de l’antigène spécifique de la prostate (PSA) ».
De plus, concernant les populations à haut risque, elle concluait :
– « qu’en l’état actuel des connaissances, des difficultés sont identifiées pour définir et repérer des populations masculines à plus haut risque de développer un cancer de la prostate ;
– que l’identification des groupes d’hommes plus à risque de développer un cancer de la prostate ne suffit pas à elle seule à justifier un dépistage ;
– qu’il n’a pas pu être retrouvé d’éléments scientifiques permettant de justifier un dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA des populations masculines considérées comme plus à risque ».
Dans un dernier document datant de mai 2013, la HAS, dans une actualisation du référentiel de pratiques de l’examen périodique de santé concernant le dépistage précoce du cancer de la prostate, réaffirme que « la balance bénéfice-risque est en défaveur du dépistage du cancer de la prostate ».
Émanant de l’AFU
Dans ses recommandations en onco-urologie publiées en 2013, l’AFU « recommandait une détection précoce individualisée du cancer de la prostate, avec une information éclairée sur les modalités, les enjeux et les risques éventuels liés aux différentes stratégies de prise en charge, avec pour objectif essentiel de ne pas méconnaître un cancer agressif… ».
Elle a maintenu, dans les recommandations 2016-2018 et 2018-2020, la même ligne générale, en préconisant les points clés de la stratégie de la détection précoce du cancer de la prostate.
Mais on note une évolution pour les dernières recommandations de 2020-2022. Il y est clairement reconnu que « dans la population générale, le bénéfice d’un dépistage n’a pas été strictement prouvé. Il n’est pas recommandé… » sauf cas d’espèce très précis (patients porteurs d’une mutation de BRCA2 et HOXB13, gènes de réparation de l’ADN).
Les préconisations détaillées portent à nouveau exclusivement sur la détection précoce (v. infra) :
– hommes avec une survie estimée supérieure à 10 ans ;
– information (y compris les modalités thérapeutiques, dont la surveillance active et leurs risques de morbidité induite potentiels) et recueil du consentement ;
– recherche d’antécédents familiaux de cancer de la prostate ;
– recherche d’une origine africaine ou afrocaribéenne ;
– toucher rectal et dosage du PSA total ;
– de 50 à 70 ans ;
– tous les 2 à 4 ans ;
– fréquence éventuellement allongée si PSA total < 1 ng/mL à 45 ou 60 ans (mais grade de recommandation faible !).
Elle a maintenu, dans les recommandations 2016-2018 et 2018-2020, la même ligne générale, en préconisant les points clés de la stratégie de la détection précoce du cancer de la prostate.
Mais on note une évolution pour les dernières recommandations de 2020-2022. Il y est clairement reconnu que « dans la population générale, le bénéfice d’un dépistage n’a pas été strictement prouvé. Il n’est pas recommandé… » sauf cas d’espèce très précis (patients porteurs d’une mutation de BRCA2 et HOXB13, gènes de réparation de l’ADN).
Les préconisations détaillées portent à nouveau exclusivement sur la détection précoce (v. infra) :
– hommes avec une survie estimée supérieure à 10 ans ;
– information (y compris les modalités thérapeutiques, dont la surveillance active et leurs risques de morbidité induite potentiels) et recueil du consentement ;
– recherche d’antécédents familiaux de cancer de la prostate ;
– recherche d’une origine africaine ou afrocaribéenne ;
– toucher rectal et dosage du PSA total ;
– de 50 à 70 ans ;
– tous les 2 à 4 ans ;
– fréquence éventuellement allongée si PSA total < 1 ng/mL à 45 ou 60 ans (mais grade de recommandation faible !).
Ces recommandations sont-elles réellement divergentes ?
Pour retenir une telle qualification, encore faudrait-il que leur objet soit identique.
On aura noté que la HAS envisage, pour lui dénier tout intérêt, « un dépistage systématique organisé » alors que l’AFU propose « une détection précoce individualisée ».
N’y a-t-il entre les deux expressions rien d’autre qu’une simple nuance, voire un « artifice sémantique », comme certains ont pu l’écrire ?
Le distinguo, et indirectement les buts recherchés, sont clairement explicités dans les récentes recommandations de l’AFU :
– « Le dépistage du cancer de la prostate consiste à rechercher la maladie de façon systématique dans une population asymptomatique… avec pour objectif la réduction de la mortalité spécifique et le maintien ou mieux encore l’amélioration de la qualité de vie de la population dépistée, éventuellement ajustée selon les coûts de la démarche… il s’agit d’une mesure de santé publique… » ;
– « La détection précoce du cancer de la prostate consiste à rechercher la maladie chez un patient asymptomatique considéré individuellement… avec un objectif spécifique individuel. Il s’agit d’une pratique médicale réalisant la synthèse de données scientifiques et des objectifs de santé propres au patient, issue d’un colloque singulier entre un médecin et ce patient ».
Ce n’est que si – et ce cas est bien peu probable ! – tous les individus de la population masculine concernée et leurs médecins avaient le même « objectif spécifique » que l’on se retrouverait dans la situation d’une « détection précoce individuelle »… pour tous ! Dès lors, et seulement dans ce cas, on pourrait parler de divergence, voire d’opposition nette, entre ces différentes recommandations.
De fait, comme il a été dit plus haut, les points de vue respectifs s’appuient sur des études statistiques, randomisées, dont les résultats sont clairement différents et dont la méthodologie fait l’objet d’une critique quasi systématique réciproque, faisant douter du bien-fondé des conclusions qui en sont tirées.
On aura noté que la HAS envisage, pour lui dénier tout intérêt, « un dépistage systématique organisé » alors que l’AFU propose « une détection précoce individualisée ».
N’y a-t-il entre les deux expressions rien d’autre qu’une simple nuance, voire un « artifice sémantique », comme certains ont pu l’écrire ?
Le distinguo, et indirectement les buts recherchés, sont clairement explicités dans les récentes recommandations de l’AFU :
– « Le dépistage du cancer de la prostate consiste à rechercher la maladie de façon systématique dans une population asymptomatique… avec pour objectif la réduction de la mortalité spécifique et le maintien ou mieux encore l’amélioration de la qualité de vie de la population dépistée, éventuellement ajustée selon les coûts de la démarche… il s’agit d’une mesure de santé publique… » ;
– « La détection précoce du cancer de la prostate consiste à rechercher la maladie chez un patient asymptomatique considéré individuellement… avec un objectif spécifique individuel. Il s’agit d’une pratique médicale réalisant la synthèse de données scientifiques et des objectifs de santé propres au patient, issue d’un colloque singulier entre un médecin et ce patient ».
Ce n’est que si – et ce cas est bien peu probable ! – tous les individus de la population masculine concernée et leurs médecins avaient le même « objectif spécifique » que l’on se retrouverait dans la situation d’une « détection précoce individuelle »… pour tous ! Dès lors, et seulement dans ce cas, on pourrait parler de divergence, voire d’opposition nette, entre ces différentes recommandations.
De fait, comme il a été dit plus haut, les points de vue respectifs s’appuient sur des études statistiques, randomisées, dont les résultats sont clairement différents et dont la méthodologie fait l’objet d’une critique quasi systématique réciproque, faisant douter du bien-fondé des conclusions qui en sont tirées.
Quels sont leurs arguments respectifs ?
Divergences
Dans ces différents rapports, la HAS rappelle le point de vue convergent des recommandations internationales publiées par les agences d’évaluation des technologies de santé et sociétés savantes (American Urological Association [AUA], US Preventive Services Task Force (USPSTF), American Cancer Society (ACS), European Association of Urology [EAU]…), aboutissant à des préconisations comparables à celles qu’elle propose.
Elle a fait siennes les conclusions de l’étude américaine randomisée PLCO (Prostate, Lung, Colon and Ovarian cancer screening) conduite entre 1993 et 2001, qui concluait à l’inutilité du dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA.
Pour l’AFU, qui s’appuie sur l’European Randomised Study of screening for Prostate Cancer (ERSPC) publiée en 2014, « si à ce jour aucune étude n’a établi de bénéfice du dépistage du cancer de la prostate par l’état global de la population dépistée… le dépistage a prouvé sa capacité à diminuer la mortalité spécifique de la maladie », par exemple gain de survie spécifique de 21 % à 16 ans selon l’étude ERSPC, concernant des hommes européens âgés de 55 à 69 ans.
De plus, « avec l’augmentation du suivi de l’étude, on observe non seulement une diminution persistante de la mortalité mais surtout une diminution du nombre de patients à dépister (570) et à traiter (18) pour obtenir ce résultat ».
De plus, « un des bénéfices avérés de la détection précoce a été la diminution considérable des formes métastatiques au diagnostic, limitant la morbidité et les coûts des traitements des formes avancées ».
En effet, par rapport à 2004, entre 2007 et 2013, on a assisté à un accroissement des formes métastatiques de 72 %.
Une étude1 a montré que la suppression du dépistage du cancer de la prostate pourrait multiplier par 3 l’incidence de ce cancer à stade avancé avant diagnostic.
Une autre2 montre une augmentation de 3 % par an entre 2011 et 2013 des patients ayant un taux de PSA supérieur ou égal à 10 mg lors du dépistage du cancer de la prostate, qui serait directement la conséquence des recommandations de 2011 de ne plus pratiquer de dosage du PSA, après l’étude PLCO, quel que soit l’âge… mais la présentation en congrès a été contestée pour défaut méthodologique !
Quant à l’étude PLCO, elle a fait en 2017 l’objet de critiques3, 4 contestant sa validité pour des raisons méthodologiques, rendant inexploitables ces résultats pour l’établissement de recommandations de bonne pratique.
Ultérieurement, la correction de ce biais « montre que le bénéfice en survie spécifique aurait dû être semblable entre les deux études (PLCO et ERSPC) ».
L’étude anglaise CAP de 2018,5 portant sur plus de 400 000 patients âgés de 50 à 69 ans, conclut que, dépistage ou non, la mortalité à 10 ans, spécifique et globale, est identique. Mais là aussi, il a été démontré que cette étude présentait des faiblesses méthodologiques !
Elle a fait siennes les conclusions de l’étude américaine randomisée PLCO (Prostate, Lung, Colon and Ovarian cancer screening) conduite entre 1993 et 2001, qui concluait à l’inutilité du dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA.
Pour l’AFU, qui s’appuie sur l’European Randomised Study of screening for Prostate Cancer (ERSPC) publiée en 2014, « si à ce jour aucune étude n’a établi de bénéfice du dépistage du cancer de la prostate par l’état global de la population dépistée… le dépistage a prouvé sa capacité à diminuer la mortalité spécifique de la maladie », par exemple gain de survie spécifique de 21 % à 16 ans selon l’étude ERSPC, concernant des hommes européens âgés de 55 à 69 ans.
De plus, « avec l’augmentation du suivi de l’étude, on observe non seulement une diminution persistante de la mortalité mais surtout une diminution du nombre de patients à dépister (570) et à traiter (18) pour obtenir ce résultat ».
De plus, « un des bénéfices avérés de la détection précoce a été la diminution considérable des formes métastatiques au diagnostic, limitant la morbidité et les coûts des traitements des formes avancées ».
En effet, par rapport à 2004, entre 2007 et 2013, on a assisté à un accroissement des formes métastatiques de 72 %.
Une étude1 a montré que la suppression du dépistage du cancer de la prostate pourrait multiplier par 3 l’incidence de ce cancer à stade avancé avant diagnostic.
Une autre2 montre une augmentation de 3 % par an entre 2011 et 2013 des patients ayant un taux de PSA supérieur ou égal à 10 mg lors du dépistage du cancer de la prostate, qui serait directement la conséquence des recommandations de 2011 de ne plus pratiquer de dosage du PSA, après l’étude PLCO, quel que soit l’âge… mais la présentation en congrès a été contestée pour défaut méthodologique !
Quant à l’étude PLCO, elle a fait en 2017 l’objet de critiques3, 4 contestant sa validité pour des raisons méthodologiques, rendant inexploitables ces résultats pour l’établissement de recommandations de bonne pratique.
Ultérieurement, la correction de ce biais « montre que le bénéfice en survie spécifique aurait dû être semblable entre les deux études (PLCO et ERSPC) ».
L’étude anglaise CAP de 2018,5 portant sur plus de 400 000 patients âgés de 50 à 69 ans, conclut que, dépistage ou non, la mortalité à 10 ans, spécifique et globale, est identique. Mais là aussi, il a été démontré que cette étude présentait des faiblesses méthodologiques !
Convergences
Les protagonistes – comme l’immense majorité des recommandations nationales ou internationales, à l’exception de celles de l’USPSTF en 2012 – sont en revanche entièrement d’accord sur un point : la nécessité de délivrer « une information claire, objective et hiérarchisée ».
Dès septembre 2004, l’ANAES – avec la participation de l’AFU ! – dans des recommandations pour la pratique clinique énonçait que lorsque la demande de dépistage était envisagée « la décision doit être partagée avec la personne qui consulte. Elle relève de son appréciation individuelle en fonction notamment de son anxiété et de son aversion pour le risque… ». « Cette décision doit (porter)… non seulement sur les bénéfices potentiels escomptés mais également les risques auxquels pourrait l’exposer ce choix, notamment en termes d’effets indésirables et de qualité de vie… »
À propos de la détection précoce, l’AFU, dans ses dernières recommandations, insiste également sur cette démarche au cours « d’un colloque entre un médecin et un patient ayant été informé de façon loyale et ayant donné son accord pour la procédure afin de s’assurer qu’elle correspond à ses attentes. L’information doit porter à la fois sur la détection, le diagnostic mais aussi sur les modalités thérapeutiques du cancer de la prostate, intégrant la surveillance active et les éventuelles séquelles des prises en charge ».
À cela rien d’étonnant, car il ne s’agit là, dans un domaine bien précis, que du devoir général d’information du médecin vis-à-vis de son patient, avant de recueillir son consentement éclairé aux actes de diagnostic ou de thérapeutique qu’il propose !
Dès septembre 2004, l’ANAES – avec la participation de l’AFU ! – dans des recommandations pour la pratique clinique énonçait que lorsque la demande de dépistage était envisagée « la décision doit être partagée avec la personne qui consulte. Elle relève de son appréciation individuelle en fonction notamment de son anxiété et de son aversion pour le risque… ». « Cette décision doit (porter)… non seulement sur les bénéfices potentiels escomptés mais également les risques auxquels pourrait l’exposer ce choix, notamment en termes d’effets indésirables et de qualité de vie… »
À propos de la détection précoce, l’AFU, dans ses dernières recommandations, insiste également sur cette démarche au cours « d’un colloque entre un médecin et un patient ayant été informé de façon loyale et ayant donné son accord pour la procédure afin de s’assurer qu’elle correspond à ses attentes. L’information doit porter à la fois sur la détection, le diagnostic mais aussi sur les modalités thérapeutiques du cancer de la prostate, intégrant la surveillance active et les éventuelles séquelles des prises en charge ».
À cela rien d’étonnant, car il ne s’agit là, dans un domaine bien précis, que du devoir général d’information du médecin vis-à-vis de son patient, avant de recueillir son consentement éclairé aux actes de diagnostic ou de thérapeutique qu’il propose !
Nature des organismes élaborant les recommandations – « hiérarchie des normes ? »
La Haute Autorité de santé
La HAS est une « autorité administrative indépendante » à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, distincte de celle de l’État, créée par la loi du 13 août 2004 ; sa mise en œuvre est effective depuis le 1er janvier 2005.
Une autorité administrative indépendante est une institution de l’État, chargée en son nom d’assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le gouvernement veut éviter d’intervenir trop directement.
Une autorité administrative indépendante a trois caractères :
– une autorité qui, en tant que telle, peut prendre des décisions exécutoires, avec parfois un pouvoir réglementaire, mais alors limité à un domaine précis ;
– administrative, elle agit au nom de l’État, et certaines compétences dévolues à l’administration lui sont déléguées ;
– indépendante à la fois des secteurs contrôlés et des pouvoirs publics. Une autorité administrative indépendante n’est pas soumise à l’autorité hiérarchique d’un ministre.
La HAS (www.data.gouv.fr) contribue à la régulation du système de santé par la qualité. Elle exerce ses missions dans les champs de l’évaluation des produits de santé, des pratiques professionnelles, de l’organisation des services et de la santé publique.
Ces missions sont définies aux articles 161-37 et suivants du code de la Sécurité sociale. Elles peuvent être regroupées en deux activités principales : évaluations et recommandations, accréditation et certification.
Entre autres mesures, elles promeuvent les bonnes pratiques et le bon usage des soins.
Une autorité administrative indépendante est une institution de l’État, chargée en son nom d’assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le gouvernement veut éviter d’intervenir trop directement.
Une autorité administrative indépendante a trois caractères :
– une autorité qui, en tant que telle, peut prendre des décisions exécutoires, avec parfois un pouvoir réglementaire, mais alors limité à un domaine précis ;
– administrative, elle agit au nom de l’État, et certaines compétences dévolues à l’administration lui sont déléguées ;
– indépendante à la fois des secteurs contrôlés et des pouvoirs publics. Une autorité administrative indépendante n’est pas soumise à l’autorité hiérarchique d’un ministre.
La HAS (www.data.gouv.fr) contribue à la régulation du système de santé par la qualité. Elle exerce ses missions dans les champs de l’évaluation des produits de santé, des pratiques professionnelles, de l’organisation des services et de la santé publique.
Ces missions sont définies aux articles 161-37 et suivants du code de la Sécurité sociale. Elles peuvent être regroupées en deux activités principales : évaluations et recommandations, accréditation et certification.
Entre autres mesures, elles promeuvent les bonnes pratiques et le bon usage des soins.
L’Association française d’urologie
L’AFU est la seule société savante représentative de la profession « fondée en 1896 et reconnue d’utilité publique, elle a pour but la promotion de la science urologique et l’étude de toute question et en particulier la recherche, la pratique professionnelle et son évaluation, l’enseignement… des affections de l’appareil urinaire dans les deux sexes et de l’appareil génital de l’homme ».
« La société savante doit clairement être distinguée d’un syndicat ou d’une association à but professionnel, structures qui appartiennent au processus décisionnel. La défense des intérêts professionnels ne doit pas interférer avec une démarche scientifique impartiale telle que recherchée dans le domaine de l’évaluation. »
L’AFU, en particulier, « est le promoteur des recommandations du comité de cancérologie de l’AFU (CCAFU)… groupe de travail multidisciplinaire… dont les membres sont choisis en raison de leur expertise dans le domaine de la cancérologie… urogénitale ». Ses recommandations sont publiées et actualisées tous les trois ans environ.
Le niveau de qualité « international » de l’AFU est une évidence, reconnue par ses équivalents d’autres pays.
« La société savante doit clairement être distinguée d’un syndicat ou d’une association à but professionnel, structures qui appartiennent au processus décisionnel. La défense des intérêts professionnels ne doit pas interférer avec une démarche scientifique impartiale telle que recherchée dans le domaine de l’évaluation. »
L’AFU, en particulier, « est le promoteur des recommandations du comité de cancérologie de l’AFU (CCAFU)… groupe de travail multidisciplinaire… dont les membres sont choisis en raison de leur expertise dans le domaine de la cancérologie… urogénitale ». Ses recommandations sont publiées et actualisées tous les trois ans environ.
Le niveau de qualité « international » de l’AFU est une évidence, reconnue par ses équivalents d’autres pays.
Quelle est la hiérarchie des normes ?
En cas de désaccord certain entre les recommandations émanant de ces deux protagonistes, quelles sont celles qui ont la plus grande force prégnante et devraient donc, en conséquence, s’imposer aux praticiens ?
C’est en quelque sorte poser le problème d’une certaine « hiérarchie des normes » qui, au moins en théorie, devrait être à l’avantage de la HAS dont la « hauteur » institutionnelle représente l’atout majeur.
Mais concernant l’AFU – et ce n’est pas le moindre de ses avantages –, on notera la régulière actualisation de ses recommandations en fonction des données scientifiques évolutives et « sans cesse enrichies par de nouvelles études », ce qui permet de les optimiser, sans délai, au mieux des intérêts des patients. Cette souplesse adaptative est, du fait de sa nature même très polyvalente, moins attendue de la part de la HAS, dont, rappelons-le, la dernière prise de position (restée certes identique) date de mai 2013 !
Dans le préambule des dernières recommandations actualisées 2020-2022, Arnaud Mejean, président du comité cancérologie de l’AFU, écrit : « Ces recommandations restent aujourd’hui la référence pour le traitement des cancers urologiques pour les étudiants en médecine, les internes et les seniors des disciplines suscitées (uropathologistes, radiologues, radiothérapeutes, oncologues médicaux et urologues) mais aussi pour les tutelles ».
Il y a fort à parier que les experts s’y référeront pour appuyer leurs conclusions !
Au-delà de cette question de primauté, il convient de s’interroger sur la véritable portée juridique des recommandations de bonne pratique (RBP).
C’est en quelque sorte poser le problème d’une certaine « hiérarchie des normes » qui, au moins en théorie, devrait être à l’avantage de la HAS dont la « hauteur » institutionnelle représente l’atout majeur.
Mais concernant l’AFU – et ce n’est pas le moindre de ses avantages –, on notera la régulière actualisation de ses recommandations en fonction des données scientifiques évolutives et « sans cesse enrichies par de nouvelles études », ce qui permet de les optimiser, sans délai, au mieux des intérêts des patients. Cette souplesse adaptative est, du fait de sa nature même très polyvalente, moins attendue de la part de la HAS, dont, rappelons-le, la dernière prise de position (restée certes identique) date de mai 2013 !
Dans le préambule des dernières recommandations actualisées 2020-2022, Arnaud Mejean, président du comité cancérologie de l’AFU, écrit : « Ces recommandations restent aujourd’hui la référence pour le traitement des cancers urologiques pour les étudiants en médecine, les internes et les seniors des disciplines suscitées (uropathologistes, radiologues, radiothérapeutes, oncologues médicaux et urologues) mais aussi pour les tutelles ».
Il y a fort à parier que les experts s’y référeront pour appuyer leurs conclusions !
Au-delà de cette question de primauté, il convient de s’interroger sur la véritable portée juridique des recommandations de bonne pratique (RBP).
Pourquoi faut-il, en pratique, appliquer des recommandations ?
Arrêt Mercier, Cour de cassation 1936
Ce célébrissime arrêt précise les obligations du médecin vis-à-vis de son patient : « … le médecin ne pouvant s’engager à guérir s’engage seulement à donner des soins… consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science… ».
Y a-t-il identité ou, du moins, superposition partielle des données acquises de la science et des recommandations de bonne pratique ?
Apportons d’abord deux propositions de définition :
– recommandations de bonne pratique (Conseil d’État) : « Les RBP… ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées sur les bases des connaissances médicales avérées à la date de leur édiction… » ;
– règles de l’art (Danièle Monestier-Carlus, colloque de l’Observatoire national et européen du droit de la santé et de l’environnement) : « Références fondamentales pour apprécier le comportement des médecins devant de multiples situations envisageables. C’est une notion difficile à définir car elles apparaissent évolutives dans le temps, plurielles selon les connaissances scientifiques des examinateurs et le comportement du sujet, informelles et approximatives avec des limites floues. Elles font intervenir la référence aux données acquises de la science dans le respect d’une obligation de prudence, de diligence et d’information. »
Une réponse est apportée pour la première fois dans un arrêt du Conseil d’État du 12 janvier 2005 (n° 256001) : « … le praticien mis en cause n’avait pas tenu compte, pour dispenser ses soins à ses patients, des données acquises de la science telles qu’elles résultent notamment des recommandations de bonne pratique élaborées par la HAS… ». Elle sera confirmée dans un arrêt ultérieur du 27 avril 2011 (n° 334396) : « … qu’eu égard à l’obligation déontologique incombant aux professionnels de santé… d’assurer au patient des soins fondés sur les données acquises de la science, telles qu’elles ressortent notamment de ces recommandations de bonne pratique… ».
En conclusion, les recommandations de bonne pratique font partie des données acquises de la science, mais elles ne les résument pas à elles seules.
– recommandations de bonne pratique (Conseil d’État) : « Les RBP… ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées sur les bases des connaissances médicales avérées à la date de leur édiction… » ;
– règles de l’art (Danièle Monestier-Carlus, colloque de l’Observatoire national et européen du droit de la santé et de l’environnement) : « Références fondamentales pour apprécier le comportement des médecins devant de multiples situations envisageables. C’est une notion difficile à définir car elles apparaissent évolutives dans le temps, plurielles selon les connaissances scientifiques des examinateurs et le comportement du sujet, informelles et approximatives avec des limites floues. Elles font intervenir la référence aux données acquises de la science dans le respect d’une obligation de prudence, de diligence et d’information. »
Une réponse est apportée pour la première fois dans un arrêt du Conseil d’État du 12 janvier 2005 (n° 256001) : « … le praticien mis en cause n’avait pas tenu compte, pour dispenser ses soins à ses patients, des données acquises de la science telles qu’elles résultent notamment des recommandations de bonne pratique élaborées par la HAS… ». Elle sera confirmée dans un arrêt ultérieur du 27 avril 2011 (n° 334396) : « … qu’eu égard à l’obligation déontologique incombant aux professionnels de santé… d’assurer au patient des soins fondés sur les données acquises de la science, telles qu’elles ressortent notamment de ces recommandations de bonne pratique… ».
En conclusion, les recommandations de bonne pratique font partie des données acquises de la science, mais elles ne les résument pas à elles seules.
Caractère opposable des recommandations ?
Pour autant, en elles-mêmes, les RBP revêtent-elles un caractère obligatoire, s’imposant au médecin dans tous les cas ?
Absence d’ambiguïté de la jurisprudence judiciaire
Tant sur le plan civil que pénal, clairement les praticiens sont tenus de respecter les RBP, sauf à courir le risque, en cas de dommage imputable, d’être poursuivis sur le fondement de ces recommandations et voir leur responsabilité retenue (v. arrêt Cass.1er Civ. 14 octobre 2010 n° 09-68471 et Cass. crim. 18 mai 2010, n° 30008).
Évolution de la jurisprudence du Conseil d’État (justice administrative)
On a vu que l’arrêt du 12 janvier 2005 reconnaissait une valeur juridique aux RBP : la référence aux RBP permet de sanctionner un médecin qui doit donc s’y conformer.
Un arrêt ultérieur du 26 septembre 2005 (n° 270234) reconnaissait pour la première fois un caractère contraignant, obligatoire, à certaines RBP, considérées comme décision faisant grief « lorsqu’elles sont rédigées de façon impérative… », c’est-à-dire comportant l’expression « il faut… » ou toute formule équivalente.
Rappelons qu’en droit administratif français, une décision « fait grief » si elle modifie par elle-même la position juridique d’une personne. Dans ce cas, elle peut faire l’objet d’une contestation pour excès de pouvoir devant le juge. Un acte qui ne présente aucun caractère exécutoire ne fait pas grief.
Dès lors, quelle valeur à accorder aux RBP à rédaction non impérative ? Avaient-elles un simple caractère d’information ? La réponse sera apportée par l’arrêt du 27 avril 2011 (n° 334396) qui utilise un biais.
C’est parce que le médecin « … a l’obligation déontologique… d’assurer au patient des soins fondés sur les données acquises de la science (que) ces recommandations de bonne pratique doivent être regardées comme des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir… ».
Autrement dit, c’est parce que les recommandations de la HAS s’intègrent à l’obligation déontologique du médecin qu’elles constituent nécessairement une norme réglementaire, que doit appliquer le médecin.
On peut donc retenir que respecter les données acquises de la science revient (entre autres) à suivre les RBP qui, en ce sens, revêtent un caractère obligatoire et que leur respect dégage le praticien de toute responsabilité.
Un arrêt ultérieur du 26 septembre 2005 (n° 270234) reconnaissait pour la première fois un caractère contraignant, obligatoire, à certaines RBP, considérées comme décision faisant grief « lorsqu’elles sont rédigées de façon impérative… », c’est-à-dire comportant l’expression « il faut… » ou toute formule équivalente.
Rappelons qu’en droit administratif français, une décision « fait grief » si elle modifie par elle-même la position juridique d’une personne. Dans ce cas, elle peut faire l’objet d’une contestation pour excès de pouvoir devant le juge. Un acte qui ne présente aucun caractère exécutoire ne fait pas grief.
Dès lors, quelle valeur à accorder aux RBP à rédaction non impérative ? Avaient-elles un simple caractère d’information ? La réponse sera apportée par l’arrêt du 27 avril 2011 (n° 334396) qui utilise un biais.
C’est parce que le médecin « … a l’obligation déontologique… d’assurer au patient des soins fondés sur les données acquises de la science (que) ces recommandations de bonne pratique doivent être regardées comme des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir… ».
Autrement dit, c’est parce que les recommandations de la HAS s’intègrent à l’obligation déontologique du médecin qu’elles constituent nécessairement une norme réglementaire, que doit appliquer le médecin.
On peut donc retenir que respecter les données acquises de la science revient (entre autres) à suivre les RBP qui, en ce sens, revêtent un caractère obligatoire et que leur respect dégage le praticien de toute responsabilité.
Possibilités d’exonération
Intervention du juge
Certains nuancent ce point de vue en relevant que « de mémoire, le juge ne s’est jamais estimé lié par une recommandation qui n’est pas édictée par une autorité créatrice de droit… ».Par ailleurs, rappelons qu’une recommandation « faisant grief » est toujours susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge… qui peut en imposer l’abandon (comme ce fut le cas d’une RBP concernant le diabète de type 2). On ne peut exclure dans le futur, devant l’éventuelle accumulation d’éléments probants, un tel devenir pour les recommandations de bonne pratique actuelle, dans le cas d’espèce.
Liberté de prescription du médecin
La liberté de prescription – ou, de façon quasi équivalente, la liberté thérapeutique – constitue le plus important des principes de la « médecine traditionnelle ».Selon le code de déontologie en son article 5, « Le médecin ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit », et en son article 8, « … le médecin est libre de ses prescriptions qui sont celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance ».
Mais si tel est bien le cas, c’est malgré tout « dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science ».
De même (article L1110-5 CSP), si « les actes de prévention, les investigations… ne doivent pas… lui (le patient) faire courir de risque disproportionné par rapport au bénéfice escompté… », c’est également « en l’état des connaissances médicales ».
On en reviendrait donc inéluctablement aux interrogations précédentes, objet de cet article !
Néanmoins, dans le cadre de cette liberté, il peut estimer qu’une recommandation ne correspond pas à la situation particulière de son patient ou plus aux données actuelles de la science, et ainsi s’en affranchir. Mais, en cas de poursuite, il devra alors apporter la preuve de son caractère inapproprié et justifier éventuellement le recours à d’autres recommandations émanant d’autres sources (sociétés savantes…) reconnues.
Précisions apportées par la présidente de la HAS
Agnès Buzyn, à l’époque présidente du collège de la HAS, a apporté les précisions suivantes retranscrites le 13 mars 2017 par Le Quotidien du médecin, qui – étonnamment – confortent les remarques précédentes :– « Les recommandations de bonne pratique de la HAS n’ont pas à être opposables car la médecine est un art évolutif… » ;
– « Les médecins doivent connaître les RBP et être capables de dire pourquoi, le cas échéant, ils s’en sont éloignés. C’est lorsque les praticiens ne justifient pas les raisons qui les ont fait s’écarter de ces recommandations qu’ils courent un risque judiciaire… ».
De même, elle reconnaît qu’une recommandation « peut devenir obsolète du fait des avancées récentes de la médecine… », évidence que nous avons relevée dans un précédent chapitre.
État actuel de la jurisprudence
À ce jour, une seule décision permet d’apprécier le point de vue du juge, en cas de contestation, sur le sujet qui nous préoccupe.
Le tribunal de grande instance de Troyes, le 22 mars 2013, en première instance, « avait débouté un patient atteint d’un cancer de la prostate qui réclamait réparation à son ancien médecin traitant en lui faisant grief de lui avoir prescrit de manière tardive un dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA ».
La cour d’appel de Reims, par un arrêt n° 13.01202 du 6 janvier 2015, a confirmé ce jugement de relaxe du médecin. Entre autres, elle a souligné deux problèmes :
– « … (la question) de savoir si ce dosage devait intervenir dans le cadre d’un dépistage en l’absence de tout symptôme ou dans le cadre d’un dépistage individuel en présence de symptômes. Il apparaît effectivement pour les motifs pertinents développés, par le tribunal et que la Cour adopte, que les développements mêlent systématiquement les considérations propres au dépistage individuel avec celles relatives au dépistage de masse »…, ce qui nous ramène à des considérations précédemment évoquées ! ;
– « l’absence de consensus scientifique sur l’opportunité préventive du dosage systématique de l’antigène de la prostate », en relevant les opinions contradictoires de la HAS, de l’Académie de médecine, et de l’AFU.
Mais la Cour de cassation (1re civ. pourvoi n° 15, 14 253 du 6 avril 2016) casse l’arrêt précédent et renvoie devant la cour d’appel de Paris (arrêt du 25 janvier 2018).
Le nouvel arrêt (qui fera lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation 1re Civ. 9 mai 2019, n° 18 – 14 344, rejeté) retient, in fine, à l’encontre du médecin traitant une perte de chance pour son patient (et donc une faute !) de 30 %.
Le tribunal de grande instance de Troyes, le 22 mars 2013, en première instance, « avait débouté un patient atteint d’un cancer de la prostate qui réclamait réparation à son ancien médecin traitant en lui faisant grief de lui avoir prescrit de manière tardive un dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA ».
La cour d’appel de Reims, par un arrêt n° 13.01202 du 6 janvier 2015, a confirmé ce jugement de relaxe du médecin. Entre autres, elle a souligné deux problèmes :
– « … (la question) de savoir si ce dosage devait intervenir dans le cadre d’un dépistage en l’absence de tout symptôme ou dans le cadre d’un dépistage individuel en présence de symptômes. Il apparaît effectivement pour les motifs pertinents développés, par le tribunal et que la Cour adopte, que les développements mêlent systématiquement les considérations propres au dépistage individuel avec celles relatives au dépistage de masse »…, ce qui nous ramène à des considérations précédemment évoquées ! ;
– « l’absence de consensus scientifique sur l’opportunité préventive du dosage systématique de l’antigène de la prostate », en relevant les opinions contradictoires de la HAS, de l’Académie de médecine, et de l’AFU.
Mais la Cour de cassation (1re civ. pourvoi n° 15, 14 253 du 6 avril 2016) casse l’arrêt précédent et renvoie devant la cour d’appel de Paris (arrêt du 25 janvier 2018).
Le nouvel arrêt (qui fera lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation 1re Civ. 9 mai 2019, n° 18 – 14 344, rejeté) retient, in fine, à l’encontre du médecin traitant une perte de chance pour son patient (et donc une faute !) de 30 %.
Quelle attitude pratique doit adopter le médecin ?
Confronté à la réalité quotidienne, conscient des enjeux pour son patient et pour lui-même, que doit faire le médecin, à son niveau de praticien de terrain ?
Il voit bien les résultats des études, pourtant approfondies, être systématiquement contestés du fait de défauts méthodologiques dont il ne comprend pas toujours la subtilité, et leurs conclusions péremptoires, ne représentant que la vérité d’un moment, décrédibilisées.
Doit-il, au vu de la décision judiciaire rappelée précédemment, se croire potentiellement « protégé » par une prescription biologique systématique qui souvent, à tort, réduit à elle seule la démarche diagnostique ?
Mais la prescription sans nuance du dosage du PSA, outre son coût financier (se rappeler la proposition finalement non retenue dans le Plan cancer 3 du non-remboursement des dosages de PSA demandés sans signe d’appel clinique chez des hommes sans risque élevé) a pu conduire à ce qui a été qualifié de « surdiagnostic » et de « surtraitement », ce dernier n’étant pas par essence réellement profitable au patient !
C’est reconnaître, concernant la pertinence du dosage du PSA sérique total dans le dépistage du cancer de la prostate, que celui-ci « a une performance médiocre ».
Le choix ne peut se résumer à « faire ou ne pas faire », sans autre nuance. C’est là qu’intervient finalement « la liberté de prescription » du praticien, qui lui confère ce pouvoir de décision circonstanciée, qui a cependant pour corollaire l’inconfortable interrogation sur le bien-fondé de la proposition faite… ou non faite.
C’est là aussi que se pose la réelle objectivité de l’information délivrée qui ne doit pas influencer la décision personnelle du patient ; on pressent à ce niveau une réelle difficulté pour le praticien, forcément orienté par sa conception propre des choses ou par ce qu’il a retenu de ses différentes lectures. Et il est bien banal de dire que seul l’intérêt du patient devrait prévaloir ! Tout le monde en est d’accord sur le principe, et pourtant les préconisations diffèrent sensiblement !
Dès lors, prétendre édicter des « conseils » pratiques peut paraître bien ambitieux.
Nous proposons néanmoins les suivants, en rappelant, dans tous les cas, que nous avons à faire à des patients asymptomatiques :
– pour ceux qui, dans les critères d’âge « raisonnables » habituellement retenus de façon consensuelle, souhaitent pour des raisons personnelles diverses être fixés – rassurés ? – sur l’existence ou non d’une éventuelle lésion néoplasique prostatique ;
– pour ceux, et dans les mêmes limites d’âge, qui consultent pour un tout autre problème médical ;
– après le minimum préalable que représentent : la recherche minutieuse d’une réelle absence symptomatique (en redisant qu’aucune symptomatologie n’est pathognomonique du cancer de la prostate débutant localisé) ; la pratique d’un toucher rectal, acte simple, non dispendieux (au plus désagréable ! mais, il est vrai, beaucoup opérateur-dépendant) ; la recherche de facteurs de prédisposition (origine ethnique, antécédents familiaux significatifs) ;
– délivrer une information complète, compréhensible et surtout loyale, concernant la totalité des items évoqués précédemment, doit précéder la prescription d’un dosage du PSA, en insistant sur les conséquences possibles subséquentes de cet acte si simple (biopsies, investigations paracliniques, traitements aux conséquences jamais anodines et d’autant plus regrettables s’ils n’étaient pas impératifs…) !
Il y a unanimité sur la préconisation d’une telle attitude, parfaitement en accord avec l’article L1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention… ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus… ».
Il ne s’agit donc pas d’une forme de lâcheté médicale qui rejetterait sur le patient la responsabilité de la décision, dans un sens ou dans un autre, car le rôle du médecin est essentiel dans la genèse du choix et de ses conséquences. Il pourrait d’ailleurs en répondre en cas de mise en cause. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on ne saurait que répéter la nécessité pour le médecin de tracer de façon systématique les contacts qu’il a eus avec son patient et ce qui a été dit et décidé au cours de ce ou de ces colloques singuliers. En cas de mise en cause, ces éléments seront déterminants pour l’appréciation de l’expert et, au-delà, celle du juge.
Il voit bien les résultats des études, pourtant approfondies, être systématiquement contestés du fait de défauts méthodologiques dont il ne comprend pas toujours la subtilité, et leurs conclusions péremptoires, ne représentant que la vérité d’un moment, décrédibilisées.
Doit-il, au vu de la décision judiciaire rappelée précédemment, se croire potentiellement « protégé » par une prescription biologique systématique qui souvent, à tort, réduit à elle seule la démarche diagnostique ?
Mais la prescription sans nuance du dosage du PSA, outre son coût financier (se rappeler la proposition finalement non retenue dans le Plan cancer 3 du non-remboursement des dosages de PSA demandés sans signe d’appel clinique chez des hommes sans risque élevé) a pu conduire à ce qui a été qualifié de « surdiagnostic » et de « surtraitement », ce dernier n’étant pas par essence réellement profitable au patient !
C’est reconnaître, concernant la pertinence du dosage du PSA sérique total dans le dépistage du cancer de la prostate, que celui-ci « a une performance médiocre ».
Le choix ne peut se résumer à « faire ou ne pas faire », sans autre nuance. C’est là qu’intervient finalement « la liberté de prescription » du praticien, qui lui confère ce pouvoir de décision circonstanciée, qui a cependant pour corollaire l’inconfortable interrogation sur le bien-fondé de la proposition faite… ou non faite.
C’est là aussi que se pose la réelle objectivité de l’information délivrée qui ne doit pas influencer la décision personnelle du patient ; on pressent à ce niveau une réelle difficulté pour le praticien, forcément orienté par sa conception propre des choses ou par ce qu’il a retenu de ses différentes lectures. Et il est bien banal de dire que seul l’intérêt du patient devrait prévaloir ! Tout le monde en est d’accord sur le principe, et pourtant les préconisations diffèrent sensiblement !
Dès lors, prétendre édicter des « conseils » pratiques peut paraître bien ambitieux.
Nous proposons néanmoins les suivants, en rappelant, dans tous les cas, que nous avons à faire à des patients asymptomatiques :
– pour ceux qui, dans les critères d’âge « raisonnables » habituellement retenus de façon consensuelle, souhaitent pour des raisons personnelles diverses être fixés – rassurés ? – sur l’existence ou non d’une éventuelle lésion néoplasique prostatique ;
– pour ceux, et dans les mêmes limites d’âge, qui consultent pour un tout autre problème médical ;
– après le minimum préalable que représentent : la recherche minutieuse d’une réelle absence symptomatique (en redisant qu’aucune symptomatologie n’est pathognomonique du cancer de la prostate débutant localisé) ; la pratique d’un toucher rectal, acte simple, non dispendieux (au plus désagréable ! mais, il est vrai, beaucoup opérateur-dépendant) ; la recherche de facteurs de prédisposition (origine ethnique, antécédents familiaux significatifs) ;
– délivrer une information complète, compréhensible et surtout loyale, concernant la totalité des items évoqués précédemment, doit précéder la prescription d’un dosage du PSA, en insistant sur les conséquences possibles subséquentes de cet acte si simple (biopsies, investigations paracliniques, traitements aux conséquences jamais anodines et d’autant plus regrettables s’ils n’étaient pas impératifs…) !
Il y a unanimité sur la préconisation d’une telle attitude, parfaitement en accord avec l’article L1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention… ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus… ».
Il ne s’agit donc pas d’une forme de lâcheté médicale qui rejetterait sur le patient la responsabilité de la décision, dans un sens ou dans un autre, car le rôle du médecin est essentiel dans la genèse du choix et de ses conséquences. Il pourrait d’ailleurs en répondre en cas de mise en cause. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on ne saurait que répéter la nécessité pour le médecin de tracer de façon systématique les contacts qu’il a eus avec son patient et ce qui a été dit et décidé au cours de ce ou de ces colloques singuliers. En cas de mise en cause, ces éléments seront déterminants pour l’appréciation de l’expert et, au-delà, celle du juge.
Décision prise par un patient bien informé
Le dépistage ou la détection précoce des tumeurs malignes pour les traiter de façon efficiente, voire les éradiquer définitivement, semble bien être une des raisons d’espérer de la médecine moderne. En matière de cancer de la prostate, cette évidence a été loin de faire consensus ; émanant d’autorités reconnues, les recommandations édictées sont loin d’être parfaitement concordantes ; d’où l’inconfort, pour ne pas dire plus, des praticiens confrontés au problème et la possible indécision de leurs patients.
Si, après précision des buts précis recherchés, les points de vue semblent finalement s’être rapprochés, nonobstant la liberté de prescription formellement reconnue au médecin, la « solution » la plus satisfaisante en la matière réside dans la délivrance d’une information objective, parfaitement loyale au patient, qui participera, in fine, à la décision qu’en toute connaissance de cause il estimera la meilleure pour lui.
Si, après précision des buts précis recherchés, les points de vue semblent finalement s’être rapprochés, nonobstant la liberté de prescription formellement reconnue au médecin, la « solution » la plus satisfaisante en la matière réside dans la délivrance d’une information objective, parfaitement loyale au patient, qui participera, in fine, à la décision qu’en toute connaissance de cause il estimera la meilleure pour lui.
* Point de vue du Pr Christian Coulange, urologue sur le site Urofrance.
Références
1. Scosyrev E, Wu G, Mohile S, Messing EM. Prostate specific antigen screening for prostate cancer and the risk of overt metastatic disease at presentation. analysis of trends over time. Cancer 2012;118:5768-76.
2. T.E Schultheiss, J.Clin.Oncol.33,2015 (suppl.7,abstr.143).
3. J.E Shoag, NEJM May,5,2016
4. A.Tsidikov et al :Reconciling the effects of sreening in prostate cancer mortality in the ERSPC and PLCO trials. Ann of int medecine 2017,5,sept.
5. R.Martin et al:the CAP randomized clinical trial. JAMA,6.3.2018
2. T.E Schultheiss, J.Clin.Oncol.33,2015 (suppl.7,abstr.143).
3. J.E Shoag, NEJM May,5,2016
4. A.Tsidikov et al :Reconciling the effects of sreening in prostate cancer mortality in the ERSPC and PLCO trials. Ann of int medecine 2017,5,sept.
5. R.Martin et al:the CAP randomized clinical trial. JAMA,6.3.2018
Dans cet article
- Plus que des divergences, une véritable polémique !
- Quels sont les enjeux ?
- Des recommandations divergentes, voire contradictoires ?
- Quels sont leurs arguments respectifs ?
- Nature des organismes élaborant les recommandations – « hiérarchie des normes ? »
- Pourquoi faut-il, en pratique, appliquer des recommandations ?
- Caractère opposable des recommandations ?
- État actuel de la jurisprudence
- Quelle attitude pratique doit adopter le médecin ?
- Décision prise par un patient bien informé