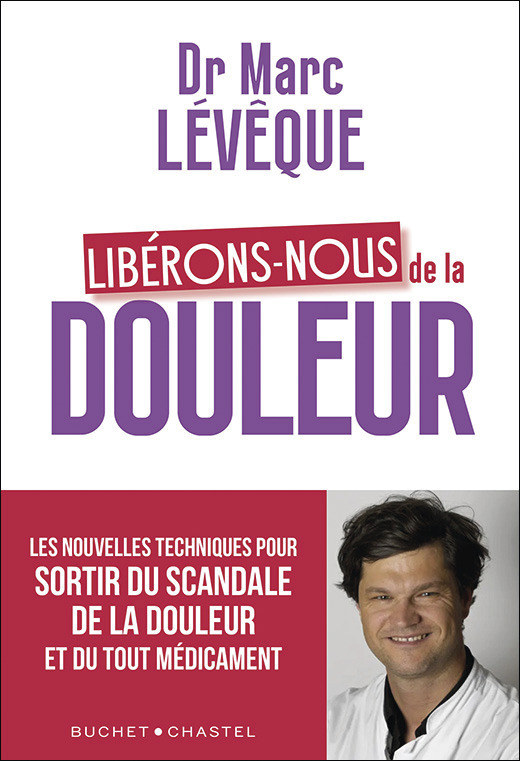Comment expliquer le boom de la consommation d’opioïdes de ces dernières années ?
Cela m’amène au point suivant, qui fait toute la complexité de la douleur chronique : ses multiples facettes, biologiques, psychologiques et sociales. Apporter le juste remède implique de bien les comprendre et de toutes les prendre en charge... ce qu’un traitement pharmacologique seul ne peut faire ! C’est ce qui explique en grande partie la crise des opioïdes aux États-Unis : la médicalisation, à grand renfort de morphiniques, du problème social qu’est celui des gueules cassées de la mondialisation (il n’est pas surprenant de constater que la carte des victimes de cette crise se superpose à celle des populations ayant voté pour Trump…) a débouché sur l’une des pires catastrophes sanitaires de l’histoire de ce pays, avec près de 100 000 Américains morts pour la seule année 2020 !
La situation en France n’est-elle pas différente ?
Si l’on n’observe pas ce phénomène en France, on constate tout de même une très forte augmentation de la prescription d’opioïdes pour les douleurs chroniques non cancéreuses (+ 88 % entre 2004 et 2017). Dans la lombalgie chronique, par exemple, on voit de plus en plus de patients arrivant avec des prescriptions de morphiniques qui sont parfois plus lourdes que celles de patients cancéreux en fin de vie !
Il est, de plus, indéniable que sur le volet social de la douleur chronique, la France ne fait pas exception. Et il ne s’agit pas seulement de mal-être social, mais d’une multitude de facteurs vis-à-vis desquels la société française est aussi vulnérable : pour revenir à l’exemple de la lombalgie, on dit toujours que c’est le mal du siècle, tant elle est la conséquence des « 4S » qui nous caractérisent aujourd’hui (sédentarité, surpoids, solitude, sénescence).
C’est là toute la limite de la seule approche médicamenteuse pour traiter un problème aussi complexe...
Quelles alternatives aujourd’hui aux médicaments ?
Pour les douleurs chroniques sévères, notamment neuropathiques, qui se manifestent sous forme de brûlures, fourmillements, allodynie (par exemple : douleurs post-zostériennes, post-traumatiques ou post-chirurgicales, lésions radiculaires chroniques par hernie discale – sciatiques ou cervicobrachialgies –, neuropathies périphériques, en particulier liées au diabète...), les diverses techniques de neuromodulation (
Comment fonctionne la neuromodulation ?
Il existe donc de nombreuses techniques adaptées à différents types de douleur, chacune ciblant une région précise de notre circuit de la douleur (
Enfin, dans certaines douleurs neuropathiques bien localisées, d’autres types de stimulation nerveuse – ciblant le versant chimique, non plus électrique, de la douleur, au moyen des neurotransmetteurs – ont également fait leurs preuves :
– les patchs de capsaïcine, dans des douleurs circonscrites à un territoire bien limité : post-zostériennes, autour d’une cicatrice ou d’un moignon d’amputation ; prescrits par un spécialiste, ils sont administrés en hôpital de jour. Des patchs « chauffants » s’inspirant du même principe existent en pharmacie, utiles pour soulager douleurs musculaires, articulaires ou menstruelles ;
– la toxine botulique, quant à elle, peut être utilisée dans ces mêmes indications mais aussi dans certaines migraines rebelles aux médicaments, les névralgies de la face et de la nuque...
Ces techniques, pourtant efficaces et ayant peu d’effets indésirables, sont malheureusement difficiles d’accès. Par exemple, la stimulation médullaire – efficace dans la douleur neuropathique d’un membre – demeure aujourd’hui positionnée par la Haute Autorité de santé comme une solution de dernier recours (après de nombreuses lignes médicamenteuses et plus d’un an d’évolution de la douleur). S’agissant des patchs de capsaïcine, des injections de toxine botulique ou de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS), ces thérapies ne sont disponibles, dans l’immense majorité des cas, que dans les centres de la douleur chronique. Or ces derniers sont saturés, et on estime que seulement 3 % des patients douloureux chroniques y sont pris en charge… Sans compter que certaines de ces alternatives non médicamenteuses, ne disposant toujours pas de codage spécifique, peinent à se développer faute de remboursement (c’est le cas de la rTMS).
Et le cannabis thérapeutique ?
L’expérimentation en cours en France, qui porte sur près de 3 000 patients, concerne surtout les douleurs neuropathiques réfractaires, certaines formes résistantes d’épilepsie, la SEP ou d’autres pathologies du système nerveux central mais, en l’absence de bras contrôle, on ne pourra pas réellement évaluer l’efficacité du cannabis thérapeutique dans ces indications.
Enfin, on peut regretter que cette expérimentation, qui devrait coûter entre 25 et 30 millions d’euros, ne bénéficie d’aucun financement. Ce sont les entreprises qui approvisionnent en produits, ce qui limite la variété des médicaments testés et introduit un conflit d’intérêts.
Quels messages peut-on donner aux généralistes ?
Autre message important : penser à « déprescrire » progressivement chez des patients souffrant de douleur chronique non cancéreuse qui sont déjà sous opioïdes depuis des mois, voire des années. On sait en effet que leur utilisation au long cours abaisse le seuil de la douleur (hyperalgésie induite par les morphiniques), les rendant d’autant plus inefficaces et augmentant les risques liés à leur surutilisation*. Le médecin traitant joue un rôle crucial dans le sevrage et la désescalade thérapeutique pour ces patients dont les ordonnances sont souvent lourdes (différents antalgiques, dont morphiniques, en association avec divers anxiolytiques...).
Il n’est pas possible d’être dans une logique de « zéro douleur » : dire au patient qu’il doit apprendre à vivre avec la douleur (lorsqu’elle est tolérable) et pour cela l’inciter à s’investir dans des « distractions », développer l’activité physique, maintenir des activités sociales, etc. Le décalage entre un objectif parfois inatteignable d’absence de douleur et la réalité peut être source d’une angoisse contribuant à majorer le mal-être.
Enfin, même s’il ne peut pas les prescrire, le médecin généraliste doit connaître ces nouvelles options thérapeutiques : son rôle est fondamental pour orienter les patients le plus rapidement possible afin d’éviter une errance thérapeutique délétère.
M. Lévêque déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.
Neuromodulation : quelles sont les différentes techniques ?
Électrostimulation transcutanée (TENS) : patch collé à la surface de la région douloureuse qui stimule électriquement les récepteurs nerveux sous la peau, permettant de bloquer le message douloureux mais aussi de déclencher la production d’endorphines.
Stimulation sous la peau : même principe que la TENS, mais dans un dispositif pérenne, avec implantation d’électrodes directement sous la peau, reliées à un neurostimulateur.
Stimulation de la moelle épinière : très efficace dans les douleurs neuropathiques ; électrode placée à l’arrière de la moelle épinière, au moyen d’un geste semblable à celui de la péridurale ; l’électrode est positionnée à l’étage de la moelle épinière qui réceptionne le message douloureux (variable donc, en fonction de la douleur ciblée).
Stimulation magnétique transcrânienne (rTMS) : stimulation non invasive (par une bobine externe) du cortex moteur. Le principe d’action demeure obscur, mais l’on estime à 50 % le taux de patients soulagés d’au moins 30 % de leur douleur. Des séances quotidiennes, d’environ vingt minutes, puis hebdomadaires et mensuelles, sont nécessaires.
- Nobile C. Opioïdes : nouvelles recos pour sécuriser la prescription. Rev Prat (en ligne), 25 mars 2022.
- Haute Autorité de santé. Traitement du trouble de l’usage des opioïdes. 10 mars 2022.

 Encadrés
Encadrés