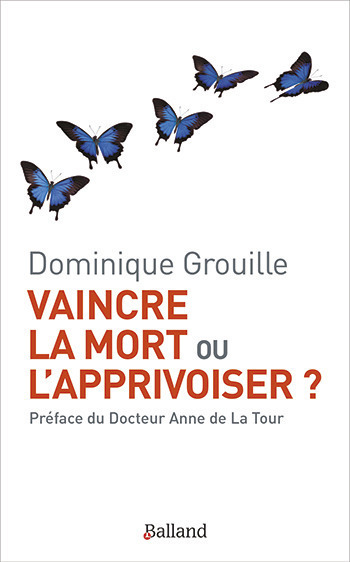Depuis quelques années, la Belgique autorise l’euthanasie, la Suisse et l’Oregon le suicide assisté. Il est maintenant possible de tirer un premier bilan de ces pratiques.
Le dépôt de trois propositions de loi sur le bureau de l’Assemblée nationale légalisant l’euthanasie et le suicide assisté1 inspirées notamment de la législation belge et hollandaise et les limites prêtées à la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite « loi Claeys-Leonetti », conduisent, par comparaison, à évaluer les législations ayant fait le choix de la dépénalisation de l’euthanasie et du suicide assisté. Il s’agit de la Belgique pour l’euthanasie et de la Suisse et de l’Oregon pour le suicide assisté. Ces trois différentes législations reposent sur le principe d’autonomie de l’individu et constituent des déclinaisons différentes d’aide à l’expression de la volonté des patients. Compte tenu de l’ancienneté de ces réglemen- tations, on dispose désormais du recul nécessaire pour les évaluer. La présente analyse se fonde exclusivement sur des études et des enquêtes scientifiques et n’a d’autre objet que d’apporter un éclairage sur des pratiques, à un moment où le débat d’une légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté est relancé avec ces trois propositions de loi.
En Belgique
Adoptée en 2002 et étendue aux mineurs en 2014, la législation belge poursuivait trois objectifs : mettre fin à des pratiques d’euthanasie clandestines, encadrer les demandes d’euthanasie et contrôler l’application de la dépénalisation de l’euthanasie. La loi belge dépénalise l’euthanasie sous réserve de plusieurs conditions. Le médecin doit s’as- surer que le patient est majeur ou mineur émancipé capable ou mineur doté de discernement et conscient au moment de la demande d’euthanasie. Le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. La demande doit être formulée par écrit et, dans l’hypothèse où le patient n’est pas en état de le faire lui-même, cette demande doit être écrite par un tiers qui ne peut avoir un intérêt matériel au décès du patient, en présence du médecin. Le médecin saisi d’une demande doit avoir au préalable informé le patient de son état de santé, de son espérance de vie, des possibilités de traitement, des soins palliatifs accessibles. Il s’agit donc d’une obligation d’information concernant les soins palliatifs et non de l’obligation imposée d’y recourir. La loi sur les droits du patient permet d’ailleurs à celui-ci de refuser toute offre de soins. La loi relative à l’euthanasie exige également que le médecin conduise plusieurs entretiens avec son patient pour s’assurer de la persistance de ses intentions, et à tout instant le patient peut renoncer à sa demande. Cette demande ne peut résulter que d’un choix, après avoir reçu toute l’information nécessaire.
Les auteurs de la proposition de loi sénatoriale à l’origine de la loi définitivement adoptée considéraient que l’état de nécessité avait pour effet de mettre à l’abri de poursuites pénales les médecins pratiquant des euthanasies. Pour eux, cette situation « entraînait des pratiques semi-clandestines, ne permettant pas le contrôle social de ces pratiques et rendant plus difficile la tenue d’un dialogue approfondi entre le patient et son médecin ». Cependant, tant implicitement les rapports de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE) que des études scientifiques révèlent que cet objectif de transparence n’a pas été atteint.
Les auteurs de la proposition de loi sénatoriale à l’origine de la loi définitivement adoptée considéraient que l’état de nécessité avait pour effet de mettre à l’abri de poursuites pénales les médecins pratiquant des euthanasies. Pour eux, cette situation « entraînait des pratiques semi-clandestines, ne permettant pas le contrôle social de ces pratiques et rendant plus difficile la tenue d’un dialogue approfondi entre le patient et son médecin ». Cependant, tant implicitement les rapports de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (CFCEE) que des études scientifiques révèlent que cet objectif de transparence n’a pas été atteint.
Le rapport du CFCEE
Dans son rapport 2016-2017 – ces rapports étant bisannuels –, la CFCEE fait valoir que, « comme déjà signalé dans les précédents rapports, la commission n’a pas la possibilité d’évaluer la proportion du nombre d’euthanasies déclarées par rapport au nombre d’euthanasies réellement pratiquées ». Les limites d’un système déclaratif avaient été perçues, à vrai dire, par la commission dès l’entrée en vigueur de la loi. Dans son premier rapport, la CFCEE reconnaissait qu’elle était « consciente des limites du contrôle de l’appli- cation de la loi du 28 mai 2002 qu’elle est chargée d’exercer. Il est évident que l’efficacité de sa mission repose, d’une part sur le respect par le corps médical de l’obligation de déclaration des euthanasies pratiquées et, d’autre part, de la manière dont ces décla- rations sont rédigées ». Les études et enquêtes conduites sur la transparence des procédures déclaratives d’euthanasie aboutissent à la même conclusion : les euthanasies déclarées ne constituent qu’une partie des euthanasies pratiquées. Par ailleurs, les procédures légales sont loin d’avoir été systématiquement respectées.
Une première enquête se rapportant à l’année 2007 a révélé que 50 % des euthanasies n’étaient pas déclarées à la CFCEE.2 Sur un échantillon de 208 personnes décédées à la suite d’une injection létale, 32 % n’avaient pas exprimé explicitement le souhait d’être euthanasiées. Dans cet échantillon, la décision n’avait même pas été discutée avec les intéressés dans 78 % des cas. Les raisons invoquées sont que le patient est comateux (70 %), dément (21 %), que la décision correspond au meilleur intérêt du patient selon les médecins (17 %), qu'en discuter avec le patient pourrait être difficile pour lui (8 %). Plusieurs raisons pouvant être invoquées, le total est supérieur à 100 %.3, 4 Le taux d’euthanasies sans demande du patient dans cette étude est le triple du chiffre noté en France : 1,8 % des décès contre 0,6 % en France et est 9 fois supérieur si l’on raisonne à partir du taux d’administrations délibérées de substances létales, soit 0,2 % des décès.5 On ajoutera qu’une part significative des euthanasies ne sont pas effectuées par des médecins et le sont en l’absence de médecins : dans 12 % des cas, les injections létales ont été administrées par des infirmières et non par des médecins. Dans cette situation, l’injection se fait sans la présence du médecin dans 64 % des cas. Dans le cadre des injections létales sans demande explicite donc hors cadre légal, les infirmières sont impliquées dans 45 % des situations. Dans ces hypothèses, l’injection se fait sans la présence du médecin dans 58 % des cas.6
La transparence limitée de la procédure n’est pas sans effet sur l’interprétation des critères de la loi par les médecins et la CFCEE. Le nombre des euthanasies déclarées est passé de 235 en 2003 à 2 309 en 2017, ce chiffre se partageant de manière régulière entre 78 % d’euthanasies en Flandre et 22 % en Wallonie. La CFCEE admet que le caractère insupportable de la souffrance exigé par la loi est en grande partie d’ordre subjectif et dépend de la personnalité du patient, des conceptions et des valeurs qui lui sont propres.7 Il convient d’ajouter que les euthanasies sont pratiquées dans plus de 53 % des cas par des médecins généralistes dont 11 % ont reçu une formation en soins palliatifs.8
La CFCEE considère dans son sixième rapport 2012-2013 que, « dans de rares cas de patients d’âge très avancé atteints de pathologies incurables multiples, certains membres de la commission ont estimé que la souffrance et la demande d’euthanasie étaient plutôt liées à l’âge qu’aux affections dont ces patients étaient atteints ». Ces pratiques ont conduit le Comité consultatif belge de bio- éthique dans son avis 73 du 11 septembre 2017 à constater que le vieillissement en lui-même était consi- déré comme une affection grave et par conséquent comme un motif légitime de demander l’euthanasie, ce qui ne correspondait pas aux intentions du législateur.9
La marge d’interprétation laissée au médecin traitant peut expliquer les dérives relevées régulièrement par les observateurs : on peut citer le cas de deux frères jumeaux de 45 ans nés sourds ;10 le cas d’une personne de 44 ans souffrant d’anorexie ;11 le cas d’une personne de 24 ans souffrant d’une dépression ayant obtenu l’autorisation d’être euthanasiée en 2004 avant d’y renoncer ;12 celui d’un détenu pour viol et meurtre qui avait également obtenu ce droit avant que la procédure ne soit arrêtée devant la polémique ainsi créée ;13 le cas d’une personne en phase terminale n’ayant écrit aucune directive anticipée, sa mort ayant été qualifiée par la CFCEE « d’interruption volontaire de vie sans demande du patient ».14
On remarque donc que, faute de critère légal clair, le curseur peut se déplacer sans rencontrer d’obstacles. Lors de l’élaboration de la loi, le législateur avait pourtant reven- diqué l’existence de barrières infranchissables. Ainsi devant la Chambre des représentants le 1er mars 2002, la commission de la Santé publique avait estimé à l’unanimité qu’une souffrance purement psychique ne pouvait jamais donner lieu à une euthanasie. Cependant, en 2014-2015, le groupe des patients souffrant en Belgique de troubles mentaux et du comportement ou d’affections psychiatriques s’élevait à 124 personnes. On pourra soutenir qu’à l’échelle des décès annuels recensés en Belgique (110 508 décès en 2015), ce chiffre est modeste, mais les évolutions impor- tent plus que les chiffres annuels bruts. Entre 2002 et 2013, les « patients psychiatriques et déments » représentaient 179 cas répertoriés. En 2013, ils constituaient 3 % des euthanasies contre 0,5 % entre 2002 et 2007. Une étude parue en 201715 rejoint ce constat et analyse la répartition des causes psychiques de ces euthanasies : « 46,4 % de personnes souffrant de dépression uniquement ; 34,6 % de personnes démentes y compris la maladie d’Alzheimer ; 12,3 % de patients atteints d’autres troubles psychiatriques et 6,7 % de personnes souffrant de dépression et d’autres problèmes psychiatriques ».
Cette évolution n’est pas restée sans réaction. Dans le journal De Morgen du 1er décembre 2015, 65 professeurs d’université, psychiatres, psychologues réclamaient qu’on modifie la loi de 2002 pour que les patients qui souffrent de douleurs psychiques et dont le décès n’est pas prévu à courte échéance n’aient plus accès à l’euthanasie. Le Dr Marc Moens, président de l’Association belge des syndicats médicaux (Absym), partage ces inquiétudes : « Depuis août 2016 et à la suite des problèmes budgétaires dans le domaine des soins aux personnes âgées, on commence à débattre d’une politique de l’euthanasie motivée par des considérations socio-économiques… Dans les journaux, on plaide aujourd’hui ouvertement en faveur de l’euthanasie des patients Alzheimer… ».16 En novembre 2016, l’Association américaine de psy- chiatrie (APA) a publié une position officielle où elle se déclare opposée à toute prescription médicale ayant pour but de causer la mort chez une personne n’étant pas en phase terminale.17
En Belgique, des personnes âgées portent maintenant des cartes pour ne pas être euthanasiées.
Si les critères des euthanasies déclarées sont sujets à une grande marge d’interprétation de la part des médecins et de la CFCCE, c’est aussi parce que le contrôle a posteriori est largement formel dans les faits. Dans son audition devant la mission parlementaire sur la fin de vie, le 3 février 2004, le vice-président du Conseil d’État français relevait que la loi belge consistait en réalité à valider l’acte d’euthanasie devant une commission une fois l’acte accompli. De fait, sur 14 573 euthanasies pratiquées entre 2002 et 2016, on ne relève qu’une seule transmission d’un dossier à la justice par la commission de contrôle, en 2015, comme si le « zéro défaut » était la règle. D’ailleurs, la CFCEE admet a contrario l’existence de cas de méconnaissance de la loi : « Dans la très grande majorité des cas, l’euthanasie est pratiquée correctement et en accord avec les données disponibles de la littérature médicale en induisant d’abord une inconscience profonde ». Elle admet par exemple que l’avis du second médecin consulté est souvent peu explicite. Le vice-président du Comité consultatif éthique belge reconnaissait quant à lui que, « depuis l’installation de la loi dépénalisant l’euthanasie, il y a une dizaine d’années, nous ne disposons pas d’une information bien claire sur la façon dont cette loi est mise en pratique ».18
La présence dans cette commission de médecins pratiquant eux-mêmes des euthanasies a été dénoncée, cette pratique étant source de conflits d’intérêts. Pour la première fois en 2018, un de ses membres a démis- sionné. Ce dernier reprochait à la commission de ne pas avoir renvoyé devant les tribunaux un médecin qui avait mis fin aux jours d’une de ses patientes sans respecter la procédure légale, la patiente n’ayant jamais fait la demande elle-même, celle-ci ayant été formulée expressément par sa famille. Dans cette affaire, le second médecin n’a donné son avis médical qu’une fois le décès intervenu.
Une première enquête se rapportant à l’année 2007 a révélé que 50 % des euthanasies n’étaient pas déclarées à la CFCEE.2 Sur un échantillon de 208 personnes décédées à la suite d’une injection létale, 32 % n’avaient pas exprimé explicitement le souhait d’être euthanasiées. Dans cet échantillon, la décision n’avait même pas été discutée avec les intéressés dans 78 % des cas. Les raisons invoquées sont que le patient est comateux (70 %), dément (21 %), que la décision correspond au meilleur intérêt du patient selon les médecins (17 %), qu'en discuter avec le patient pourrait être difficile pour lui (8 %). Plusieurs raisons pouvant être invoquées, le total est supérieur à 100 %.3, 4 Le taux d’euthanasies sans demande du patient dans cette étude est le triple du chiffre noté en France : 1,8 % des décès contre 0,6 % en France et est 9 fois supérieur si l’on raisonne à partir du taux d’administrations délibérées de substances létales, soit 0,2 % des décès.5 On ajoutera qu’une part significative des euthanasies ne sont pas effectuées par des médecins et le sont en l’absence de médecins : dans 12 % des cas, les injections létales ont été administrées par des infirmières et non par des médecins. Dans cette situation, l’injection se fait sans la présence du médecin dans 64 % des cas. Dans le cadre des injections létales sans demande explicite donc hors cadre légal, les infirmières sont impliquées dans 45 % des situations. Dans ces hypothèses, l’injection se fait sans la présence du médecin dans 58 % des cas.6
La transparence limitée de la procédure n’est pas sans effet sur l’interprétation des critères de la loi par les médecins et la CFCEE. Le nombre des euthanasies déclarées est passé de 235 en 2003 à 2 309 en 2017, ce chiffre se partageant de manière régulière entre 78 % d’euthanasies en Flandre et 22 % en Wallonie. La CFCEE admet que le caractère insupportable de la souffrance exigé par la loi est en grande partie d’ordre subjectif et dépend de la personnalité du patient, des conceptions et des valeurs qui lui sont propres.7 Il convient d’ajouter que les euthanasies sont pratiquées dans plus de 53 % des cas par des médecins généralistes dont 11 % ont reçu une formation en soins palliatifs.8
La CFCEE considère dans son sixième rapport 2012-2013 que, « dans de rares cas de patients d’âge très avancé atteints de pathologies incurables multiples, certains membres de la commission ont estimé que la souffrance et la demande d’euthanasie étaient plutôt liées à l’âge qu’aux affections dont ces patients étaient atteints ». Ces pratiques ont conduit le Comité consultatif belge de bio- éthique dans son avis 73 du 11 septembre 2017 à constater que le vieillissement en lui-même était consi- déré comme une affection grave et par conséquent comme un motif légitime de demander l’euthanasie, ce qui ne correspondait pas aux intentions du législateur.9
La marge d’interprétation laissée au médecin traitant peut expliquer les dérives relevées régulièrement par les observateurs : on peut citer le cas de deux frères jumeaux de 45 ans nés sourds ;10 le cas d’une personne de 44 ans souffrant d’anorexie ;11 le cas d’une personne de 24 ans souffrant d’une dépression ayant obtenu l’autorisation d’être euthanasiée en 2004 avant d’y renoncer ;12 celui d’un détenu pour viol et meurtre qui avait également obtenu ce droit avant que la procédure ne soit arrêtée devant la polémique ainsi créée ;13 le cas d’une personne en phase terminale n’ayant écrit aucune directive anticipée, sa mort ayant été qualifiée par la CFCEE « d’interruption volontaire de vie sans demande du patient ».14
On remarque donc que, faute de critère légal clair, le curseur peut se déplacer sans rencontrer d’obstacles. Lors de l’élaboration de la loi, le législateur avait pourtant reven- diqué l’existence de barrières infranchissables. Ainsi devant la Chambre des représentants le 1er mars 2002, la commission de la Santé publique avait estimé à l’unanimité qu’une souffrance purement psychique ne pouvait jamais donner lieu à une euthanasie. Cependant, en 2014-2015, le groupe des patients souffrant en Belgique de troubles mentaux et du comportement ou d’affections psychiatriques s’élevait à 124 personnes. On pourra soutenir qu’à l’échelle des décès annuels recensés en Belgique (110 508 décès en 2015), ce chiffre est modeste, mais les évolutions impor- tent plus que les chiffres annuels bruts. Entre 2002 et 2013, les « patients psychiatriques et déments » représentaient 179 cas répertoriés. En 2013, ils constituaient 3 % des euthanasies contre 0,5 % entre 2002 et 2007. Une étude parue en 201715 rejoint ce constat et analyse la répartition des causes psychiques de ces euthanasies : « 46,4 % de personnes souffrant de dépression uniquement ; 34,6 % de personnes démentes y compris la maladie d’Alzheimer ; 12,3 % de patients atteints d’autres troubles psychiatriques et 6,7 % de personnes souffrant de dépression et d’autres problèmes psychiatriques ».
Cette évolution n’est pas restée sans réaction. Dans le journal De Morgen du 1er décembre 2015, 65 professeurs d’université, psychiatres, psychologues réclamaient qu’on modifie la loi de 2002 pour que les patients qui souffrent de douleurs psychiques et dont le décès n’est pas prévu à courte échéance n’aient plus accès à l’euthanasie. Le Dr Marc Moens, président de l’Association belge des syndicats médicaux (Absym), partage ces inquiétudes : « Depuis août 2016 et à la suite des problèmes budgétaires dans le domaine des soins aux personnes âgées, on commence à débattre d’une politique de l’euthanasie motivée par des considérations socio-économiques… Dans les journaux, on plaide aujourd’hui ouvertement en faveur de l’euthanasie des patients Alzheimer… ».16 En novembre 2016, l’Association américaine de psy- chiatrie (APA) a publié une position officielle où elle se déclare opposée à toute prescription médicale ayant pour but de causer la mort chez une personne n’étant pas en phase terminale.17
En Belgique, des personnes âgées portent maintenant des cartes pour ne pas être euthanasiées.
Si les critères des euthanasies déclarées sont sujets à une grande marge d’interprétation de la part des médecins et de la CFCCE, c’est aussi parce que le contrôle a posteriori est largement formel dans les faits. Dans son audition devant la mission parlementaire sur la fin de vie, le 3 février 2004, le vice-président du Conseil d’État français relevait que la loi belge consistait en réalité à valider l’acte d’euthanasie devant une commission une fois l’acte accompli. De fait, sur 14 573 euthanasies pratiquées entre 2002 et 2016, on ne relève qu’une seule transmission d’un dossier à la justice par la commission de contrôle, en 2015, comme si le « zéro défaut » était la règle. D’ailleurs, la CFCEE admet a contrario l’existence de cas de méconnaissance de la loi : « Dans la très grande majorité des cas, l’euthanasie est pratiquée correctement et en accord avec les données disponibles de la littérature médicale en induisant d’abord une inconscience profonde ». Elle admet par exemple que l’avis du second médecin consulté est souvent peu explicite. Le vice-président du Comité consultatif éthique belge reconnaissait quant à lui que, « depuis l’installation de la loi dépénalisant l’euthanasie, il y a une dizaine d’années, nous ne disposons pas d’une information bien claire sur la façon dont cette loi est mise en pratique ».18
La présence dans cette commission de médecins pratiquant eux-mêmes des euthanasies a été dénoncée, cette pratique étant source de conflits d’intérêts. Pour la première fois en 2018, un de ses membres a démis- sionné. Ce dernier reprochait à la commission de ne pas avoir renvoyé devant les tribunaux un médecin qui avait mis fin aux jours d’une de ses patientes sans respecter la procédure légale, la patiente n’ayant jamais fait la demande elle-même, celle-ci ayant été formulée expressément par sa famille. Dans cette affaire, le second médecin n’a donné son avis médical qu’une fois le décès intervenu.
En Suisse
Le cadre légal suisse a ceci de particulier que le suicide assisté repose plus sur une tolérance que sur un texte de loi. L’article 114 du code pénal prohibe l’euthanasie, et l’article 115 interdit l’aide au suicide, sauf si cette aide est réalisée sans « mobile égoïste ». Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Outre que cette distinction entre mobile égoïste et mobile non égoïste constitue le fondement des pratiques du suicide assisté en Suisse, elle illustre la part occupée par l’intentionnalité dans ce geste, qui sert à démarquer l’euthanasie de la sédation en France.
En l’absence de législation, les règles sont fixées par les directives de l’Académie suisse des sciences médicales. De nouvelles directives sont entrées en vigueur en juin 2018. Elles considèrent notamment que l’assistance au suicide d’un patient capable de discernement est acceptable, lorsque les symptômes d’une maladie et/ou des limitations fonctionnelles lui causent une souffrance insupportable et que les autres options ont échoué ou ont été jugées inacceptables par le patient. Mais cette réécriture des directives s’est heurtée à la contestation de la plus importante organisation médicale suisse, la Fédération des médecins suisses, qui a estimé que le critère de l’intolérance de la souffrance était subjectif contrairement à la fin de vie qui peut être documentée de façon objective. Dans le même temps, les directives proposent des alternatives à l’assistance au suicide, qui reste une situation d’exception, l’interruption des mesures de maintien en vie, la sédation, le renoncement à l’alimentation et à l’hydratation constituant ces options alternatives.
Le Tribunal fédéral a affirmé par un arrêt de principe du 3 novembre 2006 (BGE 133 I 58 S. 59) le droit de chacun à décider de sa propre mort, les produits létaux ne pouvant être délivrés que sur ordonnance. La santé étant une compétence cantonale, des cantons comme le canton de Vaud ont par ailleurs autorisé l’assistance au suicide au sein d’un établissement médico-social (EMS) ou d’un hôpital reconnu d’intérêt public depuis le 1er janvier 2013, le Valais s’y étant opposé en 2016.
La décriminalisation de l’aide au suicide a été utilisée par des associations comme Exit-ADMD dans les cantons francophones et Dignitas principalement à Zurich. Actuellement, un médecin établit l’ordonnance du produit létal, la personne est accompagnée pendant un certain temps par un accompagnant de l’association qui lui apporte ce médicament dans le lieu choisi par la personne qui souhaite mourir et la laisse seule absorber la substance létale. La mort n’est pas déclenchée par un tiers, mais par le patient lui-même. Le président de Dignitas, Ludwig A. Minelli, a été poursuivi par le parquet de Zurich pour avoir contrevenu à l’exigence légale d’absence de motif égoïste et demandé par exemple 11 700 francs suisses pour un suicide assisté revenant en fait à 5 460 francs suisses. Il a été acquitté le 1er juin 2018 au bénéfice du doute. À l’issue d’un débat en 2011, le Conseil fédéral a considéré que donner un statut légal aux organisations d’aide au suicide pourrait avoir pour effet de postuler que des vies sont dignes de protection et d’autres non, et a plaidé in fine pour le statu quo.
Dans la pratique, le système fonctionne comme une délégation du suicide assisté à des associations militantes. Lorsqu’il a été conduit à se pencher sur les pratiques suisses, le rapport Sicard19 a estimé que l’appropriation de cette problématique par ces associations déresponsabilise totalement l’État et ne permet pas de garantir, quelle que soit leur bonne volonté, le respect absolu des indications reconnues.
L’association Exit-ADMD n’accepte que des citoyens suisses. L’association Dignitas accepte, elle, les étrangers. Pour bénéficier de ses prestations, Dignitas demande que l’on adhère à son association et exige une seule condition : « avoir une maladie ». Le coût de cette pratique est de 10 000 € (frais de dossier, crémation et transport du corps compris).
Le total des suicides assistés d’après les chiffres de l’Office fédéral statistique s’est élevé à 742 en 2014 (1,2 % des personnes décédées résidant en Suisse) contre 589 en 2013 et 300 en 2005. Le nombre de suicides assistés a doublé depuis 2001. De 1985 à 2013, 3 666 cas ont été enregistrés, la majeure partie des personnes étant des femmes, la médiane d’âge étant de 73 ans et la moitié venant de l’étranger. Sur la seule période 2008-2012, on a compté 611 suicides assistés d’étrangers en Suisse. Près de la moitié souffraient de sclérose latérale amyo- trophique, de sclérose en plaques, de maladie de Parkinson, de cancers ou de pathologies rhumatismales. Parmi ces 611 suicides, on relevait 268 Allemands, 126 Britanniques, 66 Français, 44 Italiens, 21 Américains, 14 Autrichiens et 12 Canadiens. Sur la période 1998-2011, 117 Français ont été recensés chez Dignitas, ce qui relativise l’idée souvent émise d’une émigration importante d’origine française pour accéder au suicide assisté.
Trois caractéristiques méritent de retenir l’attention : les dérives auxquelles ces pratiques ont conduit, leurs conséquences pour les proches et les médecins, ainsi que l’absence de tout réel contrôle.
En l’absence de législation, les règles sont fixées par les directives de l’Académie suisse des sciences médicales. De nouvelles directives sont entrées en vigueur en juin 2018. Elles considèrent notamment que l’assistance au suicide d’un patient capable de discernement est acceptable, lorsque les symptômes d’une maladie et/ou des limitations fonctionnelles lui causent une souffrance insupportable et que les autres options ont échoué ou ont été jugées inacceptables par le patient. Mais cette réécriture des directives s’est heurtée à la contestation de la plus importante organisation médicale suisse, la Fédération des médecins suisses, qui a estimé que le critère de l’intolérance de la souffrance était subjectif contrairement à la fin de vie qui peut être documentée de façon objective. Dans le même temps, les directives proposent des alternatives à l’assistance au suicide, qui reste une situation d’exception, l’interruption des mesures de maintien en vie, la sédation, le renoncement à l’alimentation et à l’hydratation constituant ces options alternatives.
Le Tribunal fédéral a affirmé par un arrêt de principe du 3 novembre 2006 (BGE 133 I 58 S. 59) le droit de chacun à décider de sa propre mort, les produits létaux ne pouvant être délivrés que sur ordonnance. La santé étant une compétence cantonale, des cantons comme le canton de Vaud ont par ailleurs autorisé l’assistance au suicide au sein d’un établissement médico-social (EMS) ou d’un hôpital reconnu d’intérêt public depuis le 1er janvier 2013, le Valais s’y étant opposé en 2016.
La décriminalisation de l’aide au suicide a été utilisée par des associations comme Exit-ADMD dans les cantons francophones et Dignitas principalement à Zurich. Actuellement, un médecin établit l’ordonnance du produit létal, la personne est accompagnée pendant un certain temps par un accompagnant de l’association qui lui apporte ce médicament dans le lieu choisi par la personne qui souhaite mourir et la laisse seule absorber la substance létale. La mort n’est pas déclenchée par un tiers, mais par le patient lui-même. Le président de Dignitas, Ludwig A. Minelli, a été poursuivi par le parquet de Zurich pour avoir contrevenu à l’exigence légale d’absence de motif égoïste et demandé par exemple 11 700 francs suisses pour un suicide assisté revenant en fait à 5 460 francs suisses. Il a été acquitté le 1er juin 2018 au bénéfice du doute. À l’issue d’un débat en 2011, le Conseil fédéral a considéré que donner un statut légal aux organisations d’aide au suicide pourrait avoir pour effet de postuler que des vies sont dignes de protection et d’autres non, et a plaidé in fine pour le statu quo.
Dans la pratique, le système fonctionne comme une délégation du suicide assisté à des associations militantes. Lorsqu’il a été conduit à se pencher sur les pratiques suisses, le rapport Sicard19 a estimé que l’appropriation de cette problématique par ces associations déresponsabilise totalement l’État et ne permet pas de garantir, quelle que soit leur bonne volonté, le respect absolu des indications reconnues.
L’association Exit-ADMD n’accepte que des citoyens suisses. L’association Dignitas accepte, elle, les étrangers. Pour bénéficier de ses prestations, Dignitas demande que l’on adhère à son association et exige une seule condition : « avoir une maladie ». Le coût de cette pratique est de 10 000 € (frais de dossier, crémation et transport du corps compris).
Le total des suicides assistés d’après les chiffres de l’Office fédéral statistique s’est élevé à 742 en 2014 (1,2 % des personnes décédées résidant en Suisse) contre 589 en 2013 et 300 en 2005. Le nombre de suicides assistés a doublé depuis 2001. De 1985 à 2013, 3 666 cas ont été enregistrés, la majeure partie des personnes étant des femmes, la médiane d’âge étant de 73 ans et la moitié venant de l’étranger. Sur la seule période 2008-2012, on a compté 611 suicides assistés d’étrangers en Suisse. Près de la moitié souffraient de sclérose latérale amyo- trophique, de sclérose en plaques, de maladie de Parkinson, de cancers ou de pathologies rhumatismales. Parmi ces 611 suicides, on relevait 268 Allemands, 126 Britanniques, 66 Français, 44 Italiens, 21 Américains, 14 Autrichiens et 12 Canadiens. Sur la période 1998-2011, 117 Français ont été recensés chez Dignitas, ce qui relativise l’idée souvent émise d’une émigration importante d’origine française pour accéder au suicide assisté.
Trois caractéristiques méritent de retenir l’attention : les dérives auxquelles ces pratiques ont conduit, leurs conséquences pour les proches et les médecins, ainsi que l’absence de tout réel contrôle.
Des dérives
Les raisons physiques liées à une maladie grave et incurable sont loin d’être prédominantes. Une étude réalisée en 2008 sur les demandes d’Exit a montré que 27 % des demandes étaient motivées par des dépressions. Une enquête effectuée par l’univer- sité de Zurich de 2008 a révélé que 30 % des personnes ayant fait l’objet de suicide assisté souffraient d’affections rhumatismales et de syndromes entraînant des douleurs chroniques. Des chercheurs de l’université de Zurich et de la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ont analysé les cas de décès constatés par l’Institut de médecine légale de l’université de Zurich entre 2001 et 2004 (457). L’étude prend en compte 274 personnes accompagnées par Dignitas ainsi que 147 personnes accompagnées par Exit (entre 2001 et 2004). Les chercheurs ont, en outre, comparé ces données avec une étude antérieure menée sur 149 cas d’assistance au suicide pris en charge par Exit dans la ville de Zurich entre 1990 et 2000. La part de personnes atteintes d’une maladie incurable était plus grande dans le cas de Dignitas : 79 % souffraient d’affections incura- bles comme le cancer, la sclérose en plaques ou la sclérose latérale amyo- trophique. Dans le cas d’Exit, cette part était de 67 % entre 2001 et 2004. Un médecin suisse mettait en valeur la relation entre la demande d’aide au suicide et le vieillissement mécanique de la population en 2007 dans la revue médicale suisse : « Exit propose d’offrir des services pour des maladies liées au vieillissement, qui induisent certes une perte d’autonomie et un isolement mais qui ne sont pas mortelles en soi… La solution finale proposée par Exit n’est pas sans risque de dérapages… On sait que le taux de suicides est six fois plus élevé chez les personnes âgées que dans le reste de la population ».
La fourniture de sacs d’hélium dans des voitures sur des parkings avec une absence de suivi médical des mourants,20 les réactions du parquet de Zurich devant les enregistrements vidéo de scènes d’agonie provoquées par les suicides assistés, les questions soulevées par la découverte de 67 urnes funéraires dans le lac de Zurich en 2010 ont suscité un certain trouble sur les pratiques de Dignitas.
La fourniture de sacs d’hélium dans des voitures sur des parkings avec une absence de suivi médical des mourants,20 les réactions du parquet de Zurich devant les enregistrements vidéo de scènes d’agonie provoquées par les suicides assistés, les questions soulevées par la découverte de 67 urnes funéraires dans le lac de Zurich en 2010 ont suscité un certain trouble sur les pratiques de Dignitas.
Des séquelles pour les proches et les médecins
Les suicides assistés ne sont pas sans séquelles pour les proches. Une enquête parue dans la revue European Psychiatry le 27 octobre 2012 sur les réactions de l’entourage des personnes étant décédées à la suite d’un suicide assisté en Suisse conclut que 20 % d’entre elles souffraient de troubles post-traumatiques et 16 % de dépression. Le lien entre le suicide assisté et le suicide n’est plus dissimulé : le gouvernement fédéral, dans son rapport du 15 mai 2009 sur l’assistance organisée au suicide, considère que « le travail de prévention du suicide et la promotion des soins palliatifs semblent être importants pour réduire le nombre de cas d’assistance organisée au suicide, en offrant aux personnes désireuses de mourir des alternatives ».
Cette préoccupation rejoint une appréhension de l’Observatoire français national du suicide dans son rapport de février 2018. Il rappelle que « l’association québécoise de prévention du suicide a souligné en 2013 que si l’aide médicale au suicide, le suicide assisté et l’euthanasie deviennent des options possibles, le suicide risque de devenir collectivement accepté et ainsi d’être plus facilement envisagé comme une option possible. Or la prévention du suicide vise justement à lutter contre cela en montrant aux personnes en détresse que d’autres issues sont possibles. Deux situations peuvent induire un risque de dérive : lorsque la personne qui demande qu’on l’aide à mourir souffre de troubles psychiques ou psychiatriques qui peuvent altérer sa perception et lorsque la personne envisage de mourir pour des questions existentielles. Or, dans les pays du Benelux et en Suisse (pays ayant autorisé le suicide assisté ou l’euthanasie), certaines dérives sont observées. Des médecins acceptent de fournir un produit létal à des personnes souffrant de troubles psychiatriques, sans nécessairement connaître leur parcours ».
On voit donc les contradictions dans lesquelles sont placés les pouvoirs publics lorsqu’ils veulent mener des politiques publiques de prévention du suicide tout en admettant ou en légalisant le suicide assisté.
Soutenir que le suicide assisté ne soulève pas de problème pour le corps médical serait aussi faire preuve de légèreté. Dans son analyse des pratiques suisses, le Comité français consultatif national d’éthique observe que « le corps médical est très clivé sur la question. Il faut désamorcer l’illusion qui voudrait que l’euthanasie soit simple pour le médecin à qui il est demandé de prêter son concours. Il n’est vraisemblablement pas plus facile de donner la mort, de quelque manière que ce soit, que de se suicider ».21 Sur un échantillon de 4 800 médecins, une étude de 2012 effectuée par l’Académie suisse des sciences médicales relève « qu’un bon quart des répondants tolèrent l’assistance au suicide sans toutefois être prêts à la fournir eux-mêmes et qu’un bon cinquième des répondants sont, dans tous les cas, opposés à l’assistance au suicide ».
Cette préoccupation rejoint une appréhension de l’Observatoire français national du suicide dans son rapport de février 2018. Il rappelle que « l’association québécoise de prévention du suicide a souligné en 2013 que si l’aide médicale au suicide, le suicide assisté et l’euthanasie deviennent des options possibles, le suicide risque de devenir collectivement accepté et ainsi d’être plus facilement envisagé comme une option possible. Or la prévention du suicide vise justement à lutter contre cela en montrant aux personnes en détresse que d’autres issues sont possibles. Deux situations peuvent induire un risque de dérive : lorsque la personne qui demande qu’on l’aide à mourir souffre de troubles psychiques ou psychiatriques qui peuvent altérer sa perception et lorsque la personne envisage de mourir pour des questions existentielles. Or, dans les pays du Benelux et en Suisse (pays ayant autorisé le suicide assisté ou l’euthanasie), certaines dérives sont observées. Des médecins acceptent de fournir un produit létal à des personnes souffrant de troubles psychiatriques, sans nécessairement connaître leur parcours ».
On voit donc les contradictions dans lesquelles sont placés les pouvoirs publics lorsqu’ils veulent mener des politiques publiques de prévention du suicide tout en admettant ou en légalisant le suicide assisté.
Soutenir que le suicide assisté ne soulève pas de problème pour le corps médical serait aussi faire preuve de légèreté. Dans son analyse des pratiques suisses, le Comité français consultatif national d’éthique observe que « le corps médical est très clivé sur la question. Il faut désamorcer l’illusion qui voudrait que l’euthanasie soit simple pour le médecin à qui il est demandé de prêter son concours. Il n’est vraisemblablement pas plus facile de donner la mort, de quelque manière que ce soit, que de se suicider ».21 Sur un échantillon de 4 800 médecins, une étude de 2012 effectuée par l’Académie suisse des sciences médicales relève « qu’un bon quart des répondants tolèrent l’assistance au suicide sans toutefois être prêts à la fournir eux-mêmes et qu’un bon cinquième des répondants sont, dans tous les cas, opposés à l’assistance au suicide ».
Une absence de contrôle
La Suisse partage un point commun avec la Belgique, à savoir les déficiences du contrôle. Comme le reconnaît le rapport officiel PNR 67 Fin de vie paru en 2018, « sur les suicides déclarés à l’Office fédéral de la statistique entre 1985 et 2013, un peu moins de la moitié seulement ont fait l’objet d’un examen médico-légal. Le contrôle juridique était donc insatisfaisant, et une réglementation permettant de protéger l’autonomie et le droit à la vie fait défaut ».22
Dans l’État de l’Oregon
L’Oregon Death with Dignity Act date du 27 octobre 1997 et résulte d’une initiative populaire. Pour accéder au droit au suicide assisté, la personne doit être âgée de 18 ans et plus, résider en Oregon, être capable de prendre une décision médicale et avoir fait l’objet d’un diagnostic médical conduisant à un décès à l’horizon de 6 mois. Deux demandes orales avec un intervalle de 15 jours au minimum confirmées par un écrit contresigné par deux témoins dont l’un ne doit avoir aucun lien familial avec le demandeur sont exigées. Le médecin prescrivant le produit létal doit prévenir l’entourage familial le plus proche du patient. Ce diagnostic et ce pronostic doivent être validés par le médecin prescripteur et un second médecin. Si le médecin prescripteur a un doute, il consulte un confrère psychiatre. Le médecin prescripteur doit informer le malade de la possibilité de soins palliatifs et de l’existence de traitements efficaces contre la douleur. Il est possible également de recourir aux services d’urgence.
Depuis 1997, 1 967 personnes ont eu une prescription et 1 275 d’entre elles l’ont utilisée concrètement, soit un taux de 65 %.23 Au cours de l’année 2017, 130 patients y ont eu recours sur 218, soit 59,6 % ; 80 % d’entre eux avaient plus de 65 ans, 77 % souffraient d’un cancer, 9 % d’une sclérose latérale amyotrophique ; 90 % d’entre eux sont décédés chez eux. Le taux de ces décès représentait 0,16 % du nombre total de décès dans cet État en 2016. Ce taux est stable sur une longue période. Dans la pratique, une association, la Compassion and Choices of Oregon, envoie deux de ses membres au chevet du malade pour préparer le produit létal et accompagner le malade.
Le médecin n’est pas présent en réalité au moment de l’absorption du produit. D’après le rapport 2017 précité, il n’était présent que dans 23 des cas. Cette absence du médecin traduit une certaine distance du corps médical à l’égard de ces pratiques relevées par le Comité consultatif national d’éthique dans son avis 121. L’évaluation psychiatrique n’est intervenue que dans 5 cas tant en 2017 qu’en 2016. Une seule consultation psychiatrique est permise, ce qui rend la réalité du diagnostic médical difficile. Des cas de pression de l’entourage, des raisons économiques ont été rapportées, tout comme des complications médicales lors de l’ingestion du produit létal ;24 30 patients ont régurgité ce produit entre 1998 et 2016 dont 3 en 2016.23 Le temps moyen qui s’écoule entre l’ingestion et le décès va de 10 minutes à 21 heures sur une cohorte de 31 malades, mais il y a eu des cas en 2009 où l’intervalle entre l'ingestion et le décès a duré 104 heures.25 Il est une donnée que l’on ne saurait occulter, à savoir l’arrière-plan économique de cette législation. En 2016, 70 % des patients ayant pris ce produit létal, qui au demeurant n’est pas remboursé, et 71 % en 2015 n’avaient pas ou n’avaient que la seule assurance maladie publique25 comme couverture maladie. Enfin, on constate une augmentation du nombre de suicides depuis la légalisation du suicide assisté.26
Depuis 1997, 1 967 personnes ont eu une prescription et 1 275 d’entre elles l’ont utilisée concrètement, soit un taux de 65 %.23 Au cours de l’année 2017, 130 patients y ont eu recours sur 218, soit 59,6 % ; 80 % d’entre eux avaient plus de 65 ans, 77 % souffraient d’un cancer, 9 % d’une sclérose latérale amyotrophique ; 90 % d’entre eux sont décédés chez eux. Le taux de ces décès représentait 0,16 % du nombre total de décès dans cet État en 2016. Ce taux est stable sur une longue période. Dans la pratique, une association, la Compassion and Choices of Oregon, envoie deux de ses membres au chevet du malade pour préparer le produit létal et accompagner le malade.
Le médecin n’est pas présent en réalité au moment de l’absorption du produit. D’après le rapport 2017 précité, il n’était présent que dans 23 des cas. Cette absence du médecin traduit une certaine distance du corps médical à l’égard de ces pratiques relevées par le Comité consultatif national d’éthique dans son avis 121. L’évaluation psychiatrique n’est intervenue que dans 5 cas tant en 2017 qu’en 2016. Une seule consultation psychiatrique est permise, ce qui rend la réalité du diagnostic médical difficile. Des cas de pression de l’entourage, des raisons économiques ont été rapportées, tout comme des complications médicales lors de l’ingestion du produit létal ;24 30 patients ont régurgité ce produit entre 1998 et 2016 dont 3 en 2016.23 Le temps moyen qui s’écoule entre l’ingestion et le décès va de 10 minutes à 21 heures sur une cohorte de 31 malades, mais il y a eu des cas en 2009 où l’intervalle entre l'ingestion et le décès a duré 104 heures.25 Il est une donnée que l’on ne saurait occulter, à savoir l’arrière-plan économique de cette législation. En 2016, 70 % des patients ayant pris ce produit létal, qui au demeurant n’est pas remboursé, et 71 % en 2015 n’avaient pas ou n’avaient que la seule assurance maladie publique25 comme couverture maladie. Enfin, on constate une augmentation du nombre de suicides depuis la légalisation du suicide assisté.26
UN CHOIX DE SOCIÉTÉ
Ces trois approches de la fin de vie sont inspirées par une même justification : consacrer sous des modalités différentes l’autonomie de l’individu face à la mort. Ces trois démarches n’empêchent pas cependant l’existence de dérives qui constituent autant d’illustrations de ce que d’aucuns ont dénoncé comme étant la pente glissante de ces législations et de ces pratiques. Ces trois options se différencient sur le rôle imparti au médecin dans la procédure. En Belgique, celui-ci est le véritable opérateur ; en Suisse et en Oregon, le médecin est prescripteur, l’ingestion du produit létal incombant au patient. Mais le suicide assisté se décline différemment en Suisse et en Oregon. Il est plus encadré en Oregon qu’en Suisse, l’intention constituant la distinction entre l’euthanasie et le suicide assisté en Suisse. On retient de l’Oregon que 40 % des personnes susceptibles d’y recourir ne donnent pas suite au souhait qu’elles ont exprimé antérieurement, comme si l’essentiel pour elles était que ce droit leur soit reconnu sans qu’elles décident de le mettre en œuvre en dernière analyse.
Rappeler ces faits contribue à nourrir un débat, qui n’est plus un débat médical mais un choix de société. V
Rappeler ces faits contribue à nourrir un débat, qui n’est plus un débat médical mais un choix de société. V
* Auteur du livre Vaincre la mort ou l’apprivoiser. Paris : éditions Balland, 2018.
Références
1. http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0185.asp ; http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0288.asp ; http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0517.asp
2. Smets T, Bilsen J, Cohen G, Rurup ML, Mortier F, Deliens L. Reporting of euthanasia in medical practice in Flanders, Belgium: cross sectional analysis of reported and unreported cases. BMJ 2010;341:c5174.
3. Chambaere K, Bilsen J, Cohen J, Onwuteaka-Philipsen BD, Mortier F, Deliens L. Physician-assisted deaths under the euthanasia law in Belgium: a population-based survey. CMAJ 2010;182:895-901.
4. Cohen J, Van Wesemael Y, Smets T, Bilsen J, Deliens L. Cultural differences affecting euthanasia practice in Belgium: one law but different attitudes and practices in Flanders and Wallonia. Soc Sci Med 2012;75:845-53.
5. Les décisions médicales en fin de vie. Population et Sociétés, INED, 2012, n° 494.
6. Inghelbrecht E, Bilsen J, Mortier F, Deliens L. The role of nurses in physician-assisted deaths in Belgium. CMAJ 2010;182:905-10.
7. Commission fédérale de contrôle et d’évaluation. Brochure de la CFCEE à l’intention du corps médical.
8. http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/7_rapport-euthanasie_2014-2015-fr.pdf
9. https://www.ieb-eib.org/fr/pdf/20171214-avis-ccb-euthanasie.pdf
10. Le Monde, 14 janvier 2013.
11. Le Figaro, 2 juillet 2015.
12. Libre.be, 8 décembre 2015.
13. Libération, 6 janvier 2015.
14. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_un-cas-de-deces-fait-debat-au-sein- de-la-commission-euthanasie
15. Dierick S, Deliens L, Cohen J, Chambaere K. Euthanasia for people with psychiatric disorders or dementia in Belgium: analysis of officially reported cases. BMC Psychiatry 2017;17:203.
16. Artsen Krant du 17 janvier 2017: "Gelieve tijdig sterven".
17. "The American Psychiatric Association, in concert with the American Medical Association’s position on medical euthanasia, holds that a psychiatrist should not prescribe or administer any intervention to a non-terminally ill person for the purpose of causing death".
18. Michel Dupuis dans un entretien paru dans la Libre Belgique du 23 octobre 2013 sous le titre « Euthanasie des mineurs : ne pas forcer l’agenda ».
19. http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-de-la-commission-de-reflexion-sur-la-fin-de-vie-en-France.pdf
20. Rapport d’information. Assemblée nationale 1287, T. 1, XIIIe législature, p.148.
21. Avis du Comité consultatif national d’éthique 121, p. 51.
22. http://www.pnr67.ch/SiteCollectionDocuments/nfp67-synthesebericht-fr.pdf
23. Oregon Death with Dignity Act 2017 Data Summary.
24. Some Oregon and Washington State assisted suicide abuses and complications. https://dredf.org/public-policy/assisted-suicide/some-oregon-assisted-suicide-abuses-and-complications/
25. Oregon Death with Dignity Act 2017 Data Summary.
26. Doerflinger R. A reality check on assisted suicide in Oregon, April 13, 2017. https://lozierinstitute.org/a-reality-check-on-assisted-suicide-in-oregon/
27. Hendin H, Foley K. Physician-assisted suicide in Oregon: a medical perspective. Michigan Law Rev 2008;106:1625-6.
2. Smets T, Bilsen J, Cohen G, Rurup ML, Mortier F, Deliens L. Reporting of euthanasia in medical practice in Flanders, Belgium: cross sectional analysis of reported and unreported cases. BMJ 2010;341:c5174.
3. Chambaere K, Bilsen J, Cohen J, Onwuteaka-Philipsen BD, Mortier F, Deliens L. Physician-assisted deaths under the euthanasia law in Belgium: a population-based survey. CMAJ 2010;182:895-901.
4. Cohen J, Van Wesemael Y, Smets T, Bilsen J, Deliens L. Cultural differences affecting euthanasia practice in Belgium: one law but different attitudes and practices in Flanders and Wallonia. Soc Sci Med 2012;75:845-53.
5. Les décisions médicales en fin de vie. Population et Sociétés, INED, 2012, n° 494.
6. Inghelbrecht E, Bilsen J, Mortier F, Deliens L. The role of nurses in physician-assisted deaths in Belgium. CMAJ 2010;182:905-10.
7. Commission fédérale de contrôle et d’évaluation. Brochure de la CFCEE à l’intention du corps médical.
8. http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/7_rapport-euthanasie_2014-2015-fr.pdf
9. https://www.ieb-eib.org/fr/pdf/20171214-avis-ccb-euthanasie.pdf
10. Le Monde, 14 janvier 2013.
11. Le Figaro, 2 juillet 2015.
12. Libre.be, 8 décembre 2015.
13. Libération, 6 janvier 2015.
14. https://www.rtbf.be/info/societe/detail_un-cas-de-deces-fait-debat-au-sein- de-la-commission-euthanasie
15. Dierick S, Deliens L, Cohen J, Chambaere K. Euthanasia for people with psychiatric disorders or dementia in Belgium: analysis of officially reported cases. BMC Psychiatry 2017;17:203.
16. Artsen Krant du 17 janvier 2017: "Gelieve tijdig sterven".
17. "The American Psychiatric Association, in concert with the American Medical Association’s position on medical euthanasia, holds that a psychiatrist should not prescribe or administer any intervention to a non-terminally ill person for the purpose of causing death".
18. Michel Dupuis dans un entretien paru dans la Libre Belgique du 23 octobre 2013 sous le titre « Euthanasie des mineurs : ne pas forcer l’agenda ».
19. http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-de-la-commission-de-reflexion-sur-la-fin-de-vie-en-France.pdf
20. Rapport d’information. Assemblée nationale 1287, T. 1, XIIIe législature, p.148.
21. Avis du Comité consultatif national d’éthique 121, p. 51.
22. http://www.pnr67.ch/SiteCollectionDocuments/nfp67-synthesebericht-fr.pdf
23. Oregon Death with Dignity Act 2017 Data Summary.
24. Some Oregon and Washington State assisted suicide abuses and complications. https://dredf.org/public-policy/assisted-suicide/some-oregon-assisted-suicide-abuses-and-complications/
25. Oregon Death with Dignity Act 2017 Data Summary.
26. Doerflinger R. A reality check on assisted suicide in Oregon, April 13, 2017. https://lozierinstitute.org/a-reality-check-on-assisted-suicide-in-oregon/
27. Hendin H, Foley K. Physician-assisted suicide in Oregon: a medical perspective. Michigan Law Rev 2008;106:1625-6.