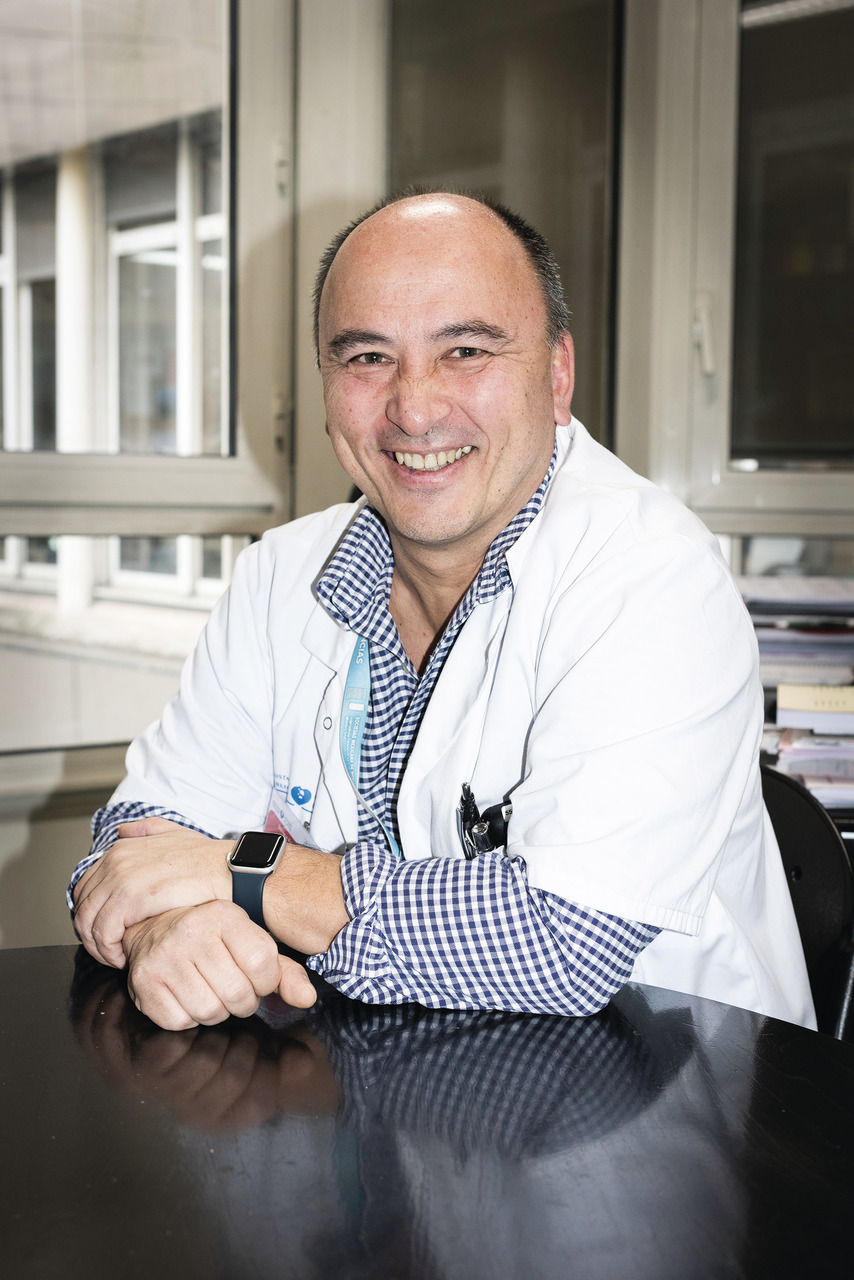Où en est notre médecine d’urgence ?
La discipline a été créée dans le milieu des années 70, d’abord en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis et en Irlande. En France, la situation était dominée par le nombre record de morts par accidents de la circulation (plus de 10 000 par an). Une première initiative est venue des anesthésistes et réanimateurs : plutôt que d’attendre l’arrivée du patient aux urgences, ils partaient le chercher avec une infirmière, en ambulance. Cette médicalisation des secours par ces spécialistes est à l’origine de la médecine d’urgence française.
Grâce à elle et aux nombreuses mesures de prévention routière adoptées (ceinture de sécurité, limitations de vitesse…), le nombre d’accidents de la route a considérablement baissé dans les années 90 (on est passé à moins de 3 000 morts par an). La discipline « médecine d’urgence » s’est développée et s’est peu à peu séparée de l’anesthésie-réanimation, ce qui a été acté en 2015 avec sa reconnaissance en spécialité. Ses consultants aussi ont changé. Aujourd’hui, la traumatologie ne représente plus qu’environ 5 % de son activité, constituée pour l’essentiel de problèmes médicaux : cardiologiques (douleurs thoraciques, infarctus du myocarde…), neurologiques (AVC) et détresses respiratoires. L’activité des services d’urgence ne ressemble absolument pas à l’image que véhiculent les séries télé, avec leurs équipes de cow-boys fonçant sur les catastrophes.
Autre bouleversement majeur : entre 1990 et 2000, le nombre de patients reçus a doublé, nous obligeant à nous adapter rapidement et en permanence, puisqu’il continue de grimper. Cela n’est pas un phénomène spécifiquement français : il existe dans le monde entier, et personne ne sait réellement l’expliquer.
La désorganisation des soins primaires est souvent avancée
Mais tout le système de soins est désorganisé, pas seulement la médecine de ville ! Je refuse de jeter la pierre aux MG, avec qui nous avons d’excellents rapports. Ils sont complètement débordés, on ne peut pas leur demander en plus d’aller faire des visites à domicile ou d’assurer des gardes la nuit. Leur problème est bien souvent qu’ils ne pourront pas avoir l’avis d’un confrère spécialiste avant plusieurs jours, donc ils envoient aux urgences, parce que les compétences sont là. En revanche, nous essayons de mettre en place des filières de soins pour des pathologies bien identifiées, par exemple la fibrillation auriculaire, avec consultation cardiologique et relais par le médecin traitant. Certaines fonctionnent déjà très bien (AVC, infarctus du myocarde, polytraumatisme). C’est cela qu’il faut développer, avec des DMP performants, hébergés par la carte Vitale, comme au Danemark, et non fermer les hôpitaux de proximité pour tout concentrer dans des mégastructures.
On invoque également le poids des patients « qui viennent pour un rien »
Dans les services, les consultants sont triés en 5 catégories. La première, c’est l’extrême urgence, soit environ 5 % de la file active. La deuxième, c’est la situation critique, mais sans risque vital immédiat : 10 à 20 % des patients. La dernière rassemble ceux dont l’état ne nécessite pas un plateau technique : 25 % du total. Ça ne veut pas dire qu’ils viennent sans raison valable. Il faut s’assurer qu’ils peuvent sortir sans complication ultérieure et avec un suivi correct. Plusieurs initiatives ont tenté de répondre à ce besoin : maisons médicales à proximité des hôpitaux, praticiens hospitaliers faisant des consultations aux urgences, etc.
Ce qui a changé, c’est la culture des patients : ils ne veulent plus attendre que leur généraliste soit disponible, puis le résultat des examens qu’il aura prescrits ou le rendez-vous avec le spécialiste… Aux urgences, même s’il faut patienter, ils pensent qu’ils auront tout sur place. Nous n’avons pas à juger cette mentalité, mais à faire avec, bien qu’un effort d’éducation du public serait très utile.
Un vrai problème pour nous, ce sont les malades âgés, fragiles et polypathologiques, qui doivent être hospitalisés. Or bien que la France ait le plus grand parc hospitalier d’Europe, nous passons notre temps à courir après des lits, pour une raison très simple : ce sont les services hospitaliers et non l’hôpital qui les gèrent. Comme aucun malade ne dépend exclusivement d’une spécialité donnée, ils rechignent à les accepter, d’où des discussions interminables avec les chefs de service. On ne peut pas leur en vouloir. Eux-mêmes ont du mal à faire sortir leurs patients par manque de lits en aval : l’HAD et les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) refusent des malades qu’ils jugent trop compliqués, les établissements de soins de suite et de réadaptation manquent de place. Comme les directeurs d’hôpitaux doivent diminuer le nombre de lits, les services sont eux aussi encombrés. Résultat : nos patients passent des heures sur un brancard, alors que cela aggrave leur état. Le personnel a le sentiment de mal travailler.
Y a-t-il des solutions ?
Oui, nombreuses, même si aucune n’est la panacée. Il faut être pragmatique, avec pour objectif de réorganiser l’hôpital. La chirurgie ambulatoire se développe, il faut en faire autant pour le médical. Beaucoup de pathologies peuvent être gérées en un temps relativement court : diabète de type 2 déséquilibré, phlébite, embolie pulmonaire, AIT, etc. mais à condition de s’organiser pour le faire au mieux.
L’ensemble du système trop hospitalo- centré doit être repensé en s’inspirant d’expériences étrangères, notamment espagnoles.
Par exemple, le lundi matin est un moment de grande affluence aux urgences. C’est aussi celui où les patients aux soins programmés arrivent dans les services ! Difficile dans ces conditions d’accepter davantage de malades. Un indicateur de sortie le matin avant midi comme lors du check-out des hôtels pourrait fluidifier les admissions des patients des urgences. Ainsi, l’hôpital de Castres a mis en place des « salons de sortie », très conviviaux et confortables, où les malades attendent qu’on vienne les chercher. Au départ, c’est une idée mise en pratique à Londres, fondée sur le « 4 hours target » (durée maximale d’attente aux urgences)...
Il faut développer les prises en charge en ville. Par exemple, à Boston, l’hôpital rémunère des infirmières d’HAD qui suivent, chacune, environ 200 patients à domicile, par téléphone.
Une problématique européenne et américaine devient chaque année de plus en plus préoccupante : le tsunami gériatrique ! Les données de la littérature internationale font apparaître un recours croissant aux urgences hospitalières pour des sujets de plus en plus âgés et polypathologiques qui voient alors leur état précaire s’aggraver. La combinaison délétère – solitude + absence d’entourage familial proche ou aidant + prix exorbitant des séjours en EPHAD – associée au manque de personnel dans ces établissements (souvent seulement une aide-soignante, rarement une infirmière de nuit), à l’absence de directives anticipées, à la pression des familles, etc. augmentent les recours inutiles aux urgences. Il est inadmissible qu’une personne âgée en fin de vie vienne y mourir alors qu’elle aurait pu être entourée dans sa chambre en EPHAD.
Plusieurs expériences de villages gériatriques, des outils de télémédecine, des objets connectés, une HAD mieux organisée et une disponibilité accrue des directives anticipées permettraient à notre société de mieux s’occuper des aînés. Au Japon, des études montrent que l’âge ne doit pas être un frein aux soins mais l’occasion de développer des alternatives au principe de « tout à l’hôpital ».
Surtout, il faut changer le management hospitalier, en commençant par admettre que l’hôpital est une entreprise, destinée non pas à faire du profit mais à être viable financièrement, y compris concernant ses investissements. Le patient doit rapporter de l’argent. Ça n’est pas politiquement correct, mais les exemples sont nombreux de pays étrangers qui ont d’excellents services d’urgence parce que leur organisation hospitalière est bonne du fait qu’ils se préoccupent de leur rentabilité. Ce ne sont pas ceux que l’on croit : le plus performant est la Turquie. Les urgences de l’hôpital d’Istanbul accueillent en moyenne 1 000 patients par jour, dans de bonnes conditions. Les pays d’Asie sont également très efficaces, notamment la Chine (Shenzhen) ou Singapour. En Australie, les urgentistes sont très contents de leur situation. Au lieu de se plaindre, il faut s’inspirer des expériences qui fonctionnent.
Second point : les établissements doivent être dirigés ou codirigés par des médecins. Nous avons actuellement à tous les niveaux des responsables administratifs formés au management industriel. Il nous faut de véritables chefs d’entreprise, et des individus ayant de l’expérience.
Et la pénurie de personnel ?
Elle n’est pas une cause de la crise des urgences, mais une conséquence. Je connais des praticiens qui ont su rentabiliser leur service, en générant de l’activité, ce qui leur a permis d’embaucher une infirmière supplémentaire, et non pas l’inverse !
De même, on incrimine souvent la faiblesse des rémunérations. C’est toujours mieux d’être bien payé, bien sûr. Mais les intérims à 2 000 euros la garde, c’est franchement du sale boulot, qui vous laisse complètement insatisfait. Regardez Dubaï : de très bons salaires certes, mais de très mauvaises conditions de travail et un manque de considération flagrant.
En fait, le problème avec les professionnels français, c’est qu’ils refusent de s’adapter aux changements. Prenons le cas des infirmières de pratique avancée. Leurs équivalents anglais, les nurses practitionners, ont fait leurs preuves depuis vingt ans : dans des limites bien définies, elles prescrivent médicaments et examens complémentaires, savent lire une radio, suivent des patients, aussi bien que les médecins. En France, leur création est très récente. Mais elles n’ont aucune reconnaissance financière, ce qui n’encourage pas les vocations. Tout ce qu’elles font doit être avalisé par un médecin. La résistance ne vient pas que du corps médical, mais aussi de la corporation infirmière elle-même, qui invoque les problèmes de responsabilité. Ainsi aucune ne veut prescrire de la morphine à un patient arrivé aux urgences, qui devra souffrir pendant des heures en attendant l’arrivée du médecin !
Je suis convaincu que râler ne sert à rien. Ce qui fonctionne, c’est monter un projet, le présenter avec son coût mais aussi avec ce qu’il va rapporter, financièrement, en termes de qualité de soins et de prestige, dans une échéance donnée. Il faut cesser de refuser toute discussion sur la rentabilité ou la performance au prétexte que ça n’est pas de la médecine. ça l’est ! Quand un malade reste bloqué dans un lit parce que toute la filière est désorganisée, cela veut dire que 20 autres ne pourront pas prendre sa place et seront mal soignés.
Refondation des urgences : les mesures pour la médecine de ville
Le Pacte de refondation des urgences d’Agnès Buzin comprend plusieurs mesures qui concernent la médecine ambulatoire.
Création d’un service d’accès aux soins, le fameux SAS, destiné à répondre à la demande des 43 % de patients qui pourraient être pris en charge ailleurs qu’aux urgences. Par téléphone ou internet, chacun pourra obtenir un conseil médical ou paramédical, prendre rendez-vous avec un généraliste, réaliser une téléconsultation, ou être orienté vers un service d’urgence ou la structure adéquate disponible. Une réalité à l’été 2020.
Structuration des offres de soins sans rendez-vous grâce aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).
Installation de maisons médicales de garde à proximité des principaux services d’urgence.
Possibilité donnée au Samu de solliciter un transport sanitaire pour conduire un patient à un rendez-vous en libéral.
Équipement des médecins libéraux en terminaux pour qu’ils proposent le tiers payant à leurs patients.
Possibilité de réaliser des examens de biologie médicale simples et automatisés sur le lieu de la consultation.