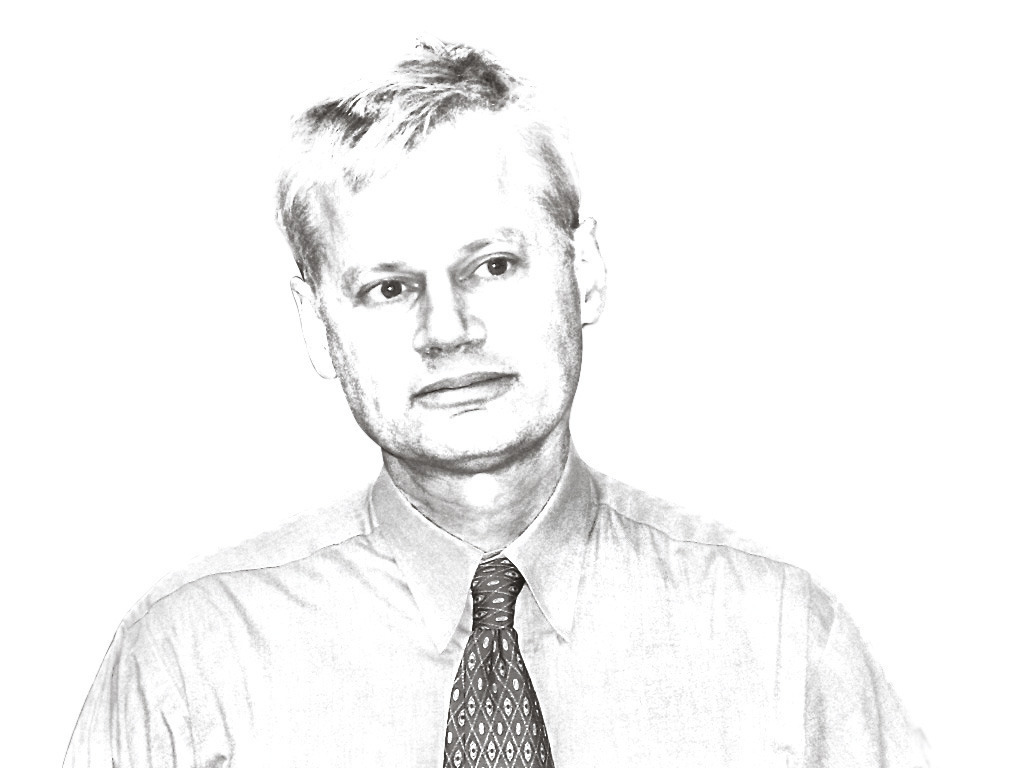Les milliers de patients qui se sont plaints de troubles variés avec la nouvelle formule de Levothyrox ne se sont vu opposer à leur colère que des commentaires condescendants voire méprisants. L’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) a maintenu que le médicament était fiable et n’a fourni, avec retard, que des données partielles quand celles du dossier d’autorisation de mise sur le marché lui ont été demandées. Le laboratoire Merck s’est abrité derrière la conformité réglementaire de son étude de bioéquivalence qui, fondée sur la moyenne des valeurs de biodisponibilité au cours du temps chez un peu plus de 200 sujets sains testés et qui étaient leur propre témoin, ne montrait pas de différence entre les deux formules. Quand les données de cette étude lui seront demandées par l’ANSM et des chercheurs, il fournira des documents images et non des données informatisées rendant quasi impossible leur analyse. Enfin d’éminents endocrinologues attribueront les troubles décrits à un effet nocebo entretenu par les réseaux sociaux et une mauvaise information des patients. Après quelques hésitations, la ministre de la Santé sera plus prudente, décidant une réintroduction temporaire de l’ancien Levothyrox et tentant de rassurer les patients et leurs associations en demandant une enquête sur l’information réalisée et la gestion de la crise, enquête qui se révèlera catastrophique pour les pouvoir publics. Au total l’ensemble des instances professionnelles, industrielles et administratives ont globalement fait bloc contre les malades sans chercher à écouter leur mal être, considéré comme imaginaire voire complotiste et en refusant de proposer la moindre étude pour essayer de comprendre.
Un début de reconnaissance scientifique des troubles est enfin intervenu grâce à une équipe qui a réussi à reprendre toutes les données de l’étude de bioéquivalence et a montré que si en moyenne celle-ci semblait satisfaisante, en réalité la variabilité de la biodisponibilité était importante en fonction de la formule utilisée pour 60 % des individus testés, cela dans le sens du sous- ou du surdosage, ce qui expliquait la valeur de la moyenne (v. page 599) et ainsi expliquer, compte tenu de la faible marge thérapeutique du médicament, une partie des symptômes ressentis par les malades ainsi déséquilibrés dans leur traitement.
Quelles leçons tirer de ce bras de fer avec les malades ? Certes, il faut revoir et améliorer les tests d’évaluation des médicaments et de la bioéquivalence et que l’ANSM ait les moyens de contrôler les études fournies. Il faut que les autorités et les professionnels jouent la transparence en cas de crise et apprennent à sortir de leur certitude quand un problème apparaît. Mais surtout il faut apprendre à considérer les patients comme des citoyens responsables et donc à écouter leur parole. Les malades n’ont pas forcément raison, loin de là, mais s’ils posent des questions c’est parce que leur quotidien est souvent beaucoup plus difficile que ne l’imaginent les médecins. Donner corps à la démocratie sanitaire, c’est les faire participer, avec leurs représentants, à tous les niveaux décisionnels concernant la gestion de leur santé, c’est de ce fait reconnaître leur expertise sur le vécu de leur maladie et ainsi faire progresser la recherche sur leur prise en charge. Cette affaire montre l’importance de mettre en œuvre rapidement les études permettant de valider ou d’invalider le ressenti des patients et non de nier leur parole. Si l’enjeu est d’améliorer leur qualité de vie et de les rassurer, il est aussi de prévenir ces crises sanitaires qui ne font qu’éroder la confiance des citoyens vis-à-vis des professionnels et des instances dirigeantes.